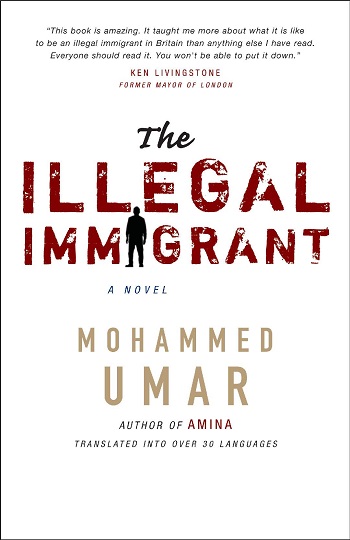Pour bien comprendre la portée politique du débat qui s’est instauré autour de la révision des accords de défense signés au moment des indépendances, en 1960, entre les nouveaux États africains et l’ancienne puissance coloniale, et parfois révisés légèrement, comme avec le Sénégal en 1974, il est indispensable de rappeler dans quel contexte général les premiers engagements ont été souscrits et les conséquences qu’ils ont eues sur le cours de la vie politique en Afrique, pendant près d’une quarantaine d’années.
Aujourd’hui encore, sous des formes plus subtiles, mais tout aussi pernicieuses (comme au Tchad en février 2008) et par delà les nombreuses et parfois rocambolesques interventions militaires françaises (en 1979 David Dacko avait été emmené dans les soutes à bagages d’un « transall » de l’armée française participant à une opération visant à renverser Bokassa) ces accords de défense ont longtemps illustré les dérives de la politique africaine de la France.
D’une manière générale, le volet militaire a été la clé de voute du système de coopération mis en place en 1960 et destiné à perpétuer, par-delà les changements institutionnels liés à l’accession à la souveraineté internationale des anciennes colonies, la domination multiforme de la France. Cet objectif transparaissait déjà très clairement dans une lettre adressée le 15 juillet 1960 par Michel Debré, alors Premier ministre français, au futur président de la République gabonaise, Léon M’Ba. Il y était dit, sans détour, que la France « donne l’indépendance à condition que l’État une fois indépendant s’engage à respecter les accords de coopération signés antérieurement. Il y a deux systèmes qui entrent en vigueur simultanément : l’indépendance et les accords de coopération. L’un ne va pas sans l’autre ». Ce qui était vrai du Gabon, l’a été aussi pour tous les autres États d’Afrique subsaharienne, anciennement colonisés par la France.
C’est dire que les accords militaires (appelons-les ainsi, même si ce vocable recouvre des situations différentes selon les pays, et des liens plus ou moins étroits renforcés avec certains États par l’installation de bases permanentes de l’armée française) s’inscrivaient dans un cadre plus global concernant la quasi-totalité des domaines de souveraineté des nouveaux États. Cela englobait tout autant les questions de défense et les matières premières « stratégiques » (ce terme est utilisé tel quel dans les accords s’y rapportant) que la politique étrangère ou la politique économique, financière et monétaire, définie à l’intérieur d’une zone franc dont la monnaie, le franc CFA, ne se voyait par reconnaître la personnalité internationale, et dont les réserves étaient versées, totalement dans un premier temps, et majoritairement ensuite, au Trésor français.
Même si au fil des ans l’emprise de la France dans un grand nombre de domaines concernés par les accords signés en 1960 et amendés ou révisés ultérieurement, s’est inévitablement relâchée face à un exercice plus effectif de la souveraineté par les partenaires africains, désormais parties prenantes à la mondialisation, et donc engagés dans de nouveaux espaces de solidarité et de coopération internationales, cette évolution n’a pas pour autant remis en cause l’esprit, voire l’essence du système mis en place en 1960. En témoigne aujourd’hui encore la perpétuation d’une politique interventionniste de la France, qui tout en ne prenant plus les formes extrêmes, voire caricaturales, d’une action militaire avec l’envoi de parachutistes ou de gendarmes, pour maintenir l’ordre et conforter des régimes « amis » ou plutôt des présidents « amis », confrontés à des oppositions intérieures, n’en aboutit pas moins aux mêmes résultats que naguère.
Cette politique interventionniste s’adosse désormais aux dispositifs internationaux de règlement des conflits et utilise les réseaux d’influence dont la France dispose, que ce soit au Conseil de sécurité de l’ONU ou à l’Union Européenne, voire à l’Union Africaine.
I – Linterventionnisme militaire de la France en Afrique
Depuis 1964, c’est-à-dire depuis la première intervention militaire au Gabon qui a permis de rétablir au pouvoir le Président Léon M’Ba, évincé par un coup d’État (abstraction faite d’une intervention plus « feutrée » au Sénégal lors du vrai-faux coup d’État de Mamadou Dia, en décembre 1962), les relations franco-africaines ont été jalonnées, pendant plus de trois décennies par toute une série d’interventions militaires aux motivations essentiellement politiques.
Si l’argument de la stabilité associé à des considérations stratégiques liées, entre autres, à la guerre froide (contenir la poussée communiste, notamment en Afrique Centrale – ex-Zaïre par exemple) a été avancé par les responsables français pour justifier certaines interventions militaires, la plupart d’entre elles étaient sous-tendues par des liens personnels, des intérêts en tout genre, pas toujours honorables, voire des pressions du « syndicat » des Chefs d’État sur l’Exécutif français. Face à de pareilles situations, et cela réduit la portée des accords en tant que tels, les autorités françaises ne se sont en fait jamais embarrassées de savoir s’il existait ou non un accord avec le ou les pays concernés, et de quel type d’accord il s’agissait.
Dans presque tous les cas d’intervention, autres qu’humanitaires, le gouvernement français a agi en s’abritant derrière l’appel qui lui était lancé par les autorités africaines concernées, sans se préoccuper de l’existence ou non d’accords l’autorisant à intervenir. En réalité, l’interventionnisme français s’est rarement fondé sur le dispositif juridique prévu en la matière.
Le concours militaire de la France a souvent résulté, comme l’écrivait un des hauts responsables militaires, qui a occupé d’importantes fonctions auprès du président Senghor lors des événements de 1968 au Sénégal, le général Fricaud Chagnaud (Revue de Défense Nationale de décembre 1997) « d’accords de défense ou de coopération militaire, largement interprétés », quand il n’a pas été fourni « dans une semi clandestinité, comme au Rwanda dans les années 80 ». Il existait avant les dernières révisions des accords de défense avec le Cameroun, le Togo et le Gabon un large éventail d’accords régissant les relations militaires entre la France et l’Afrique. Cela allait des accords de défense (au nombre de huit), plus ou moins restrictifs (avec le Sénégal, seule la défense extérieure est concernée), aux accords d’assistance et de coopération technique (28) recouvrant des objets pouvant varier d’un Etat à un autre, en passant par des conventions demeurées secrètes. L’existence de tels accords secrets dont certains garantissaient même « l’intégrité physique » de quelques chefs d’Etat (et leur évacuation en cas de troubles intérieurs) n’a jamais été contestée.
Cette confusion juridique en dit long sur les difficultés que l’on rencontre à identifier clairement les interventions, tant elles ont été variées, à les faire ressortir de telle ou telle catégorie (ce qui n’est pas sans conséquence sur l’étendue des missions assignées aux forces françaises), et à distinguer dans les opérations entreprises à la demande des gouvernements africains, celles qui visaient à prévenir ou stopper une agression extérieure de celles que l’on pouvait assimiler à des actions de police intérieure.
En fait, les gouvernements français successifs ont toujours réagi au cas par cas, se réservant le droit d’apprécier discrétionnairement la gravité des situations et les conséquences qu’une intervention pouvait avoir, tant sur le plan intérieur que régional ou international. Cette position a été constante aussi bien avant qu’après 1970. Si dans le cas du Gabon (en 1964), la France avait dépêché ses parachutistes pour rétablir au pouvoir Léon M’Ba (en se fondant sur une demande formulée par l’ambassadeur du Gabon en France), un an auparavant, elle n’avait pas jugé « opportun » de répondre à une demande d’aide de l’abbé Fulbert Youlou au Congo Brazaville.
Plus tard, le gouvernement français ne donnera aucune suite aux demandes d’intervention que lui avaient adressées les présidents nigériens, Hamani Diori, en 1974, et tchadien François Tombalbaye, en 1975. Cette neutralité, en soi synonyme d’intervention par omission, fut également affichée dans d’autres circonstances, en particulier lors de certains coups d’Etat militaires (en Côte d’Ivoire le 19 septembre 2002).
Par ailleurs la dimension extérieure des accords de défense n’a été que de façade. Dans les faits, les interventions militaires de la France en Afrique n’ont jamais été réellement répondu, à une ou deux exceptions près, au Tchad, en 1983 et 1986, à des véritables menaces ou des agressions extérieures visant les partenaires africains. En revanche, celles-ci ont été souvent brandies pour mener ce qui n’était rien d’autre que des opérations de maintien de l’ordre visant à assurer la survie des régimes en place. Ce fut, entre autres, le cas au Togo, en 1986 (en pleine cohabitation Mitterrand–Chirac) où sous prétexte d’une agression du Ghana voisin, l’armée française est venue en aide au général Eyadema en butte à une opposition intérieure conduite par Gilchrist Olympio, alors réfugié au Ghana.
D’autres exemples de ce genre se sont présentés à plusieurs reprises au Tchad et dans le Zaïre de Mobutu.
Face aux critiques de plus en plus vives émises, aussi bien par les opinions africaines que françaises, à l’égard d’un interventionnisme militaire « d’un autre âge », et prenant acte également des changements intervenus sur le plan international, les dirigeants français excelleront dans l’art du « maquillage » sémantique de leur prétendue nouvelle doctrine en matière de politique africaine. Il n’est jusqu’à Jacques Chirac qui, en 1997, déclarait solennellement que « la période des interventions unilatérales en Afrique était close » (ce qui ne l’empêchera pas deux ans plus tard de demander l’envoi de gendarmes français pour voler au secours de Henri Konan Bédié, en Côte d’Ivoire.
Par la suite, notamment sous la cohabitation Chirac–Jospin entre 1997 et 2002, la doctrine de non ingérence en Afrique se déclinera selon la formule « ni ingérence, ni indifférence » et sera même plus tard « théorisée » par Dominique de Villepin (dans une conférence prononcée à l’IHEDN) pour vanter la stratégie politique diplomatique mise en œuvre par la France en Côte d’Ivoire. C’est très certainement de ce même répertoire de la rupture avec les anciennes pratiques interventionnistes, que chacun s’accorde à considérer comme étant l’un des facteurs principaux de la dégradation de l’image de la France en Afrique que procède le big-bang de Nicolas Sarkozy, en Afrique du Sud, en 2008.
II – Portée et limites d la renégociation des accords de défense entre les Etats africains et la France
Au Cap, en Afrique du Sud, en février 2008, le président français a en effet annoncé sans détour que la France allait remettre à plat son dispositif militaire en Afrique (avec la suppression de certaines bases permanentes) et de renégocier les accords de défense qui « reflètent l’Afrique d’hier ». En réalité, à travers ce discours, a priori novateur, le président français a certes pris en compte le rejet qu’inspirent les dérives de la politique de la France « auprès des nouvelles générations d’Africains, comme d’ailleurs dans l’opinion française », mais surtout, il a fixé de nouvelles orientations dictées tout à la fois par des considérations de politique intérieure française, ou tout simplement des raisons financières ainsi que par des nouvelles priorités stratégiques, liées, parmi d’autres raisons, à la réintégration de la France au sein de l’OTAN.
En 2009, un processus de renégociation des accords de défense entre les États africains et la France a été lancé et a d’ores et déjà abouti à la signature de nouveaux engagements avec le Togo, le Cameroun et le Gabon. Libellés dans des termes très généraux, où l’accent est surtout mis sur l’idée de partenariat et le partage d’informations en matière de sécurité dans la région, les nouveaux accords se caractérisent surtout par la volonté des parties de respecter les standards internationaux en la matière, et donc de traduire le souci des pays africains d’inscrire l’aide de la France dans le cadre de relations comparables à celles déjà nouées avec d’autres États.
En réalité, le seul point de discussion plus poussé des négociations a concerné les pays africains sur le territoire desquels il y a des bases permanentes françaises, en l’occurrence le Gabon, la Côte d’Ivoire et le Sénégal. Si dans le cas de la Côte d’Ivoire, la partie ivoirienne a très tôt exprimé son souhait de rétablir sa souveraineté sur la base de Port Bouet, située dans la périphérie d’Abidjan, les négociateurs sénégalais, quant à eux, et jusqu’à l’annonce officielle par la France, en février 2010, de ne maintenir qu’une seule base sur la côte Atlantique, à savoir Libreville, n’avaient pas fait part d’une telle exigence. On sait ce qu’il en a été par la suite.
Par un effet d’annonce dont il a le secret, le président sénégalais a solennellement présenté, dans son discours à la Nation à la veille de la Fête Nationale (Ndlr : le 4 avril), la restitution de la base française comme un acte politique symbolique de la volonté de son pays d’affirmer dans sa plénitude sa souveraineté nationale.
Il est donc indéniable que le nouveau dispositif militaire français en Afrique, avec notamment la suppression de certaines bases permanentes, dont celle de Dakar, renvoie aux orientations contenues dans le Livre de la Défense adopté en 2008, et qui prônait le maintien d’une seule base sur le littoral ouest africain. Cette décision répondait avant tout à des impératifs budgétaires comparables à ceux qui avaient conduit les autorités françaises, dès 2009, à réduire les effectifs de l’armée, tous corps confondus, et à concentrer leur lieu de stationnement sur le territoire français, ce qui a conduit à la fermeture d’un certain nombre de bases.
Le redéploiement de la présence militaire en Afrique est également indissociable de la réorientation de la politique étrangère de la France depuis 2007, du rapprochement avec les États-Unis, et surtout du retour au sein des structures militaires intégrées de l’OTAN. C’est de ce changement de priorités stratégiques assignées désormais à l’armée française que procèdent l’engagement militaire en Afghanistan et l’installation d’une base permanente à Abou Dhabi.
Mais au-delà des préoccupations française prises en compte dans les nouveaux accords de défense signés ou en cours de négociation avec les États africains, il n’est pas dit que cette évolution mette fin à toute forme d’interventionnisme,. Des événements récents, en Mauritanie, à Madagascar, voire en Guinée, ont montré que les pratiques d’ingérence de l’ancienne puissance coloniale peuvent se manifester par le canal des mécanismes internationaux de prévention et de règlement des conflits au sein desquels la France joue un rôle prépondérant et où elle est toujours en mesure de faire entériner ses positions. C’est bel et bien ce qu’a démontré l’exemple de la Côte d’Ivoire où, sous couvert d’une gestion internationale du conflit, la France a utilisé tous les leviers politiques et diplomatiques dont elle dispose (notamment au sein du Conseil de sécurité de l’ONU) pour faire passer sa solution politique. En d’autres temps, sans doute, la France aurait utilisé d’autres moyens plus radicaux et moins orthodoxes pour parvenir à ses fins politiques.
III – La gestion internationale des conflits en Afrique sous l’emprise politique de la France
Paradoxalement l’évolution vers une doctrine présentée comme désormais fondée sur la non ingérence dans les affaires intérieures des pays africains va permettre à la France de consolider sa présence militaire sur le Continent et surtout d’exercer une influence déterminante sur les modalités de « sorties de crise » arrêtées dans les enceintes internationales. Mise en œuvre pour la première fois, lors de la crise centrafricaine, en 1997-1998, à travers la création de deux forces internationales, d’abord africaine, la Mission de surveillance des accords de Bangui (MISAB), ensuite la Mission des Nations Unies en RCA (MINURCA), encadrées l’une et l’autre par l’armée française, cette nouvelle stratégie d’intervention de la France s’est précisée, en République démocratique du Congo (RDC), en 2003, par l’envoi d’une force multinationale d’urgence dépêchée à Bunia, dans la région de l’Ituri, et placée sous commandement de la France.
Cette doctrine atteindra sa maturation, tout au long de la crise ivoirienne, du coup d’État manqué du 19 septembre 2002 à l’Accord politique de Ouagadougou, du 4 mars 2007 qui concrétise le dialogue direct entre le pouvoir central et la rébellion. La démarche française consistera à combiner l’adoption d’une solution politique, concoctée par Paris (l’Accord de Marcoussis, dont étaient exclus le chef de l’État ivoirien et l’armée nationale ivoirienne), et avalisée par une conférence internationale (Kléber) convoquée à Paris au forceps, avec sa légitimation par le Conseil de sécurité de l’ONU. Mieux encore, la résolution du Conseil du 4 février 2003, présentée par la France, insèrera dans le mécanisme de sécurité de l’ONU l’intervention militaire française (l’opération Licorne) pourtant décidée unilatéralement par le pouvoir politique français, cinq mois avant, et placée sous commandement français.
Ainsi, sous les apparences d’un strict respect de la légalité internationale et surtout sous couvert d’actions concertées avec l’ONU, l’Union Européenne et les grandes organisations internationales africaines, dont l’Union Africaine, la France aura de fait, surtout de par sa qualité de membre permanent du Conseil de sécurité, la conduite de la gestion du dossier ivoirien, et donc les moyens d’imposer sa propre vision de la solution du conflit ivoirien, dont la finalité était d’évincer Laurent Gbagbo du pouvoir. C’est bel et bien du registre de ce qu’il faut bien appeler une instrumentalisation des dispositifs universels et régionaux de maintien de la paix, que vont relever les scénarios les plus « abracadabrantesques » de partage du pouvoir, la création d’un Groupe de travail international (GTI) qui était ni plus ni moins l’instrument de mise en œuvre du projet « fou » de mise sous tutelle de la Côte d’Ivoire. Mais à trop vouloir en faire, la France se heurtera au refus des quatre autres membres permanents du Conseil de sécurité et surtout des États-Unis, d’adopter la première mouture d’un projet de résolution, en octobre 2006, présentée bien sûr par Paris, qui bafouait les principes les plus élémentaires du droit international, comme par exemple la souveraineté étatique, sur lesquels repose l’ONU.
Dans un style moins unilatéral, et des cadres moins formels que ceux utilisés dans le cas de la Côte d’Ivoire, la France est parvenue à obtenir le déploiement d’une force des Nations Unies (la MINURCAT) au Tchad, pays dans lequel elle joue un rôle prépondérant du fait même d’une présence militaire permanente (l’opération Epervier) depuis le milieu des années 80.
C’est dire que, si pour des raisons multiples sur lesquelles il n’est pas besoin de s’étendre (entre autres une plus grande exigence de souveraineté des partenaires africains) l’interventionnisme militaire de naguère n’est plus de mise et que résumait fort bien un ancien ministre français des Affaires étrangères, Louis de Guiringaud (« l’Afrique est le seul continent qui soit à la mesure de la France… le seul où elle puisse avec cinq cents hommes changer le cours de l’histoire »), la France a encore du mal en Afrique à se défaire de certaines pratiques politiques qui portent encore la marque de son passé colonial.
* Albert Bourgi est professeur des Universités en Droit public. Ce texte est une communication présentée au colloqué organisé par la Fondation Gabriel Peri et le Parti de l’indépendance et du travail-Sénégal, organisé à Dakar les les 18 et 19 mai 2010
* Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur www.pambazuka.org
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 2086 lectures