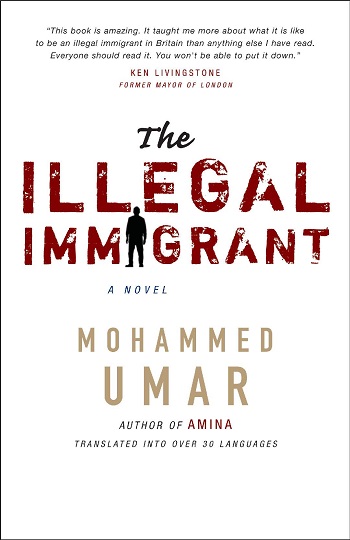Concernant les universités africaines, il y a deux hypothèses communément répandues : la première consiste à dire que les universités ont été introduites en Afrique par les Européens et la seconde que celles-ci connaissent un déclin depuis l’indépendance. Selon Paul Zeleza, les deux sont fausses. L’enseignement supérieur, y compris celui dispensé par les universités, est antécédent à l’institution d’universités de style occidental au XIXe siècle et la période qui a suivi l’indépendance a vu une prolifération sans précédent d’universités africaines.
Le discours concernant l’Afrique continue d’être infecté par ce qu’il était convenu de nommer dans les années 80 et 90, l’afro-pessimisme, une croyance qui fait de l'Afrique le lieu irrémédiablement condamné au chaos et à l’arriération. L’afro- pessimisme est l’expression de deux tendances : d’une part le dénigrement de l’expérience africaine et la valorisation de l’engagement des Européens et des Américains, et d’autre part, du postulat que l’Afrique est incapable par elle-même de progresser et que le progrès qu’il peut y avoir est nécessairement le résultat de l’intervention des Européens ou des Américains.
Le discours concernant l’enseignement supérieur en Afrique n’a pas échappé à cette logique. Il y a deux hypothèses communément répandues concernant l’enseignement supérieur en Afrique : premièrement que ce sont les Européens qui l’ont introduit et deuxièmement que cet enseignement a décliné depuis l’indépendance. Les deux sont fausses. L’enseignement supérieur, y compriscelui dispensé par les universités, est antécédent à l’institution d’universités de style occidental au XIXe siècle et la période qui a suivi l’indépendance a vu une prolifération sans précédent d’universités africaines.
En ma qualité d’historien profondément engagé dans la transformation sociale et dans le développement de l’Afrique, je crois que l’histoire- dans une perspective à long terme, est un antidote puissant au fatalisme souvent induit par le flux des évènements actuels et qui veut que l’afro-pessimisme soit une tendance irrémédiable. Dans ce cas, en ma qualité d’intellectuel intéressé autant par l’histoire des idées que par les institutions dispensatrices de savoir, je suis naturellement intéressé par le débat global concernant le futur de l’enseignement supérieur et le besoin d’une réelle compréhension de l’histoire longue et compliquée de l’enseignement tertiaire me paraît impérative. Je propose ici une brève réflexion sur l’histoire et les défis qui attendent les universités africaines contemporaines.
L’origine des universités africaines, y inclus les communautés de savants et d’érudition, remontent à trois traditions institutionnalisées : premièrement le musée et la bibliothèque d’Alexandrie, deuxièmement les premiers monastères chrétiens et troisièmement les universités des mosquées musulmanes. Le musée et la bibliothèque d’Alexandre ont été établis en Egypte au IIIe siècle avant notre ère. Il s’est développé jusqu’à devenir le plus grand centre d’érudition de l’ancien monde. Ce complexe - selon les estimations- a abrité plus de 200 000 volumes et hébergé jusque 5000 savants et étudiants.
Clairement, ce lieu était un grand centre d’étude et nombreux sont les érudits qui, à un moment ou un autre de leur vie, qu’ils soient Africains, Grecs, Romains ou Juifs, ont étudié ou travaillé à Alexandrie. La bibliothèque a décliné dès lors qu’elle a été pillée au cours de guerres, qu’un incendie l’a détruite et que les savants sont partis en raison de l’instabilité politique qui a prévalu lors de la fin de l’empire romain. Néanmoins, Alexandrie laissait un riche héritage couvrant des domaines aussi variés que les mathématiques et les sciences, la philosophie et la religion.
C’était également en Egypte, l’un des premiers centre du christianisme du monde, que les monastères se sont d’abord développé au IIIe siècle de notre ère. Des dizaines de milliers de Chrétiens ont rejoint les monastères du désert, non seulement pour fuir les exactions des Romains, mais également pour se consacrer à une vie de contemplation.
Les monastères et les ordres monastiques qui les ordonnaient ont fourni un important espace pour la réflexion, l’écriture et l’acquisition de savoir. Les idées et l’institution même des monastères se sont répandus largement dans d’autres parties de l’Afrique et dans d’autres parties du monde aussi loin que l’Angleterre et la Géorgie en Europe et en Perse ainsi qu’en Inde en Asie, qui ont donné naissance aux universités qui se sont développés par la suite.
L’Ethiopie, où le christianisme a été introduit au IVe siècle de notre ère et où il est devenu religion d’Etat, a introduit très tôt l’enseignement dans les monastères. Depuis la période de la dynastie de Zagwe au XIIe siècle, le système comprenait également un enseignement supérieur réservé au seul clergé et à la noblesse. Au bas du système il y avait Qine Bet (Ecole des hymnes), puis venait Zema Bet (l ‘Ecole de Poésie). Au sommet il y avait Metsashift Bet (Ecole des Livres Sacrés) qui dispensait un enseignement plus large et plus spécialisé dans les études religieuses, la philosophie, l’histoire, la computation du temps et l’établissement de calendrier, ces sujets parmi d’autres.
Mais c’est la troisième tradition, l’Islam, qui a donné à l’Afrique la première institution prodiguant un enseignement supérieur qui a persisté jusqu’à nos jours. En effet, l’Afrique revendique l’honneur d’avoir sur son sol les plus anciennes universités islamiques du monde dont certaines existent encore de nos jours. Celles-ci comprennent Ez-Zitouna madrassa à Tunis fondée en 732. En 859 une jeune princesse, du nom de Fatima Al Fihri , émigrée de Quairawan (Tunisie), fonda à Fez l’université de Al Qarawyyin.
Cette université de l’Afrique de l’Ouest attirait les étudiants et les savants de l’Espagne andalouse. En 969, l’université de la mosquée Al Azhar était établie au Caire, l’année même de la fondation de la ville par la dynastie des Fatimides du Maghreb. Ce centre acquit une grande réputation et devint un lieu prestigieux d’érudition qui a attiré les plus grands intellectuels du monde musulman, y cmpris Ibn Khaldun le célèbre historien qui y a enseigné. Sankore a été une autre université islamique, située à Tombouctou, qui a été fondée au XIIe siècle et qui dispensait une vaste palette de disciplines qui couvrait la théologie, la logique, l’astronomie, l’astrologie, la grammaire, la rhétorique, l’histoire et la géographie.
L’héritage des anciennes universités islamiques pour l’Afrique moderne a trois aspects.
Premièrement nombre de ces universités islamiques ont survécu à travers les siècles et sont toujours en existence, bien qu’elle aient subi d’importants changements au cours du temps, en particulier par l’introduction de disciplines plus séculaires faisant la part belle aux domaines techniques et professionnels. La seule exception est l’université de Sankore.
Deuxièmement, dans la mouvance de la privatisation de l’enseignement supérieur, qui fait suite à la diminution du contrôle de l’Etat, de nombreuses universités islamiques ont vu le jour récemment, réparties dans différents pays d’Afrique, souvent reproduisant le modèle des anciennes universités islamiques.
Troisièmement, les universités de type occidental que les Européens ont introduites en Afrique au XIXe siècle portaient la marque de l’influence de l’Islam. L’Europe a hérité des Musulmans un immense corpus de savoir, une construction élaborée du savoir, la notion d’étude individuelle, le concept de collège, toutes choses qui devinrent des aspects centraux des universités européennes et que les Européens ont exportés dans le reste du monde au cours de la montée de l’impérialisme de l’Europe.
Les missionnaires européens et africains, y inclus ceux de la diaspora, ont initialement entrepris d’introduire en Afrique les universités de style occidental. Le processus était principalement concentré dans les colonies d’Afrique du Sud, d’Algérie ainsi que dans la Sierra Leone et le Libéria qui étaient les terres nouvellement destinées à accueillir les Africains de la diaspora.
La première université était le collège de Fourah Bay fondé en Sierra Leone en 1826 suivie plus de trois décennies plus tard, en 1862, par la fondation de Liberia College. Ces deux institutions sont devenues des centres rayonnant dans toute l’Afrique de l’Ouest qui ont attiré l’intelligentsia coloniale et ont été le berceau du nationalisme émergent. Edward Blyden, le célèbre savant cum activiste panafricain, était activement impliqué dans ces deux écoles. De surcroît, il y avait une série de plus petits collèges au Liberia.
Pendant ce temps, des institutions obéissant aux normes de la ségrégation étaient établies en Afrique du Sud dès 1829, avec le South African College au Cap (qui est devenu plus tard l’université du Cap) et qui accueillait principalement des colons anglais. En 1866, une école à l’intention des immigrés Afrikaners a été créée du nom de Stellenbosch Gymnasium qui, en 1918 est finalement devenu l’université de Stellenbosch.
Une petite école pour les Africains, l’institut de Lovedale a été créé en 1841 et a été graduellement façonné sur le modèle des collèges industriels et professionnels afro-américains des Etats-Unis. Puis en 1873, l’université of the Cape of Good Hope (renommée the university of South Africa en 1916) a été établie, initialement comme centre d’examens avant de devenir une des principales sources africaines et mondiales d’enseignement à distance.
Comme en Afrique du Sud, l’enseignement supérieur dans l’Algérie française était l’apanage quasi exclusif des colons. Au commencement, en 1857 vint la création d’une école de médecine suivie en 1879 par l’établissement de quatre facultés spécialisées respectivement en médecine, pharmacie, sciences, ainsi qu’une faculté de lettres et de droit, lesquelles ont fusionné en 1909 pour former l’université d’Alger. Madagascar, une autre colonie française, a vu la création à la fin du XIXe siècle – en 1896 - la fondation de l’Académie Médicale d’Antananarivo.
Ce n’est qu’au XXe siècle, dans la mouvance de la conquête coloniale européenne que les universités coloniales ont commencé à se répandre sur le reste du continent. Deux pays ont échappé à la colonisation, le Libéria et l’Ethiopie, mais tous deux ont cherché à moderniser leurs systèmes d’enseignement.
Au Liberia, où le modèle américain était populaire, Cuttington university College a été créée en 1949 avec l‘aide de l’Eglise Episcopale et le Liberia College, détruit par un incendie à la fin des années 40, a été reconstruit en 1951 pour constituer l’université du Libéria. La brève occupation italienne de l’Ethiopie (1935-1941) a stimulé les Ethiopiens à moderniser leur système d’enseignement. En 1949, le gouvernement a fondé Trinity College qui est nommé dans la charte octroyée en 1950, University College of Addis-Ababa, et qui en en 1961 est devenu l’université de Hailé Selassie.
Dans l’Afrique coloniale, le développement de l’enseignement supérieur est resté limité jusqu’à la fin de la 2ème guerre mondiale, les autorités coloniales craignant les élites africaines modernes et leurs revendications nationalistes pour l’égalité et la liberté. Par ailleurs, les fonctionnaires coloniaux redoutaient la compétition. Les Africains qui voulaient accéder à un enseignement supérieur devaient le plus souvent l’acquérir à l’étranger, en particulier dans les métropoles impériales. Au cours de cette période, l’enseignement supérieur n’avait cours que dans les empires français et anglais. Ni les Portugais ni les Belges n’ont fourni de telles prestations.
La première université coloniale en Afrique du Nord a été le Gordon Memorial College, fondée au Soudan en 1902, qui est devenue Khartoum University College en 1951 avant de devenir Khartoum University à l’indépendance en 1956. 1912 voit la fondation de l’Institut Islamique qui devient un collège en 1924 avant que d’être renommé l’Omdurman Islamic University en 1965. En Egypte, l’université du Caire a été fondée en 1908 malgré l’opposition véhémente du gouverneur colonial. Elle s’est développée au point de devenir une des plus grandes universités africaines avec une population estudiantine de 155 000 et plus 5500 enseignants.
En 1938, elle essaime à Alexandrie et pose ainsi le fondement de ce qui allait devenir en 1942, l’université d’Alexandrie. En Afrique du Sud, une nouvelle ère commence en 1916 pour l’enseignement supérieur avec l’établissement du Inter State Native College plus tard renommé l’University College de Fort Hare. Fort Hare est devenu un aimant attirant non seulement les étudiants noirs d’Afrique du Sud mais également des étudiants en provenance d’autres pays d’Afrique australe comme le montre les registres et qui ont inclus des chefs nationalistes comme Nelson Mandela, Seretse Khama et Robert Mugabe.
Ailleurs, avant la guerre, quelques institutions ont vu le jour qui fonctionnaient le plus souvent comme des écoles secondaires ou comme collège technique avant d’être convertis - après la guerre - en universités. Les exemples de l’époque coloniale incluent Makerere Government College établi en Ouganda en 1949.
Au Nigeria, Yaba Higher College a été établi en 1932 a servi des années durant comme la principale institution dispensant un enseignement supérieur. Au Ghana, il y avait le Government Training College qui a été formellement inauguré en janvier 1927 avant que de devenir le Prince of Wales School and College, Achimota. Parmi ses enseignants les plus illustres on compte le Dr Kwegyir Aggreey, l’éminent éducateur et, parmi ses étudiants, on retrouve le nom de Kwame Nkrumah qui a obtenu son certificat d’instituteur en 1930. Ces écoles étaient souvent affiliées à des universités britanniques qui s’employaient à fournir les cours, la matière des examens et octroyaient l’accréditation.
Dans les colonies françaises, le développement de l’enseignement supérieur a été entravé par la préférence marquée, tant des autorités coloniales que des élites africaines, pour un enseignement suivi en métropole ce qui est le résultat de l’idéologie et de la politique d’assimilation. Par ailleurs, l’enseignement fourni par les missionnaires était limité ce qui a partiellement empêché le développement de l’enseignement primaire et secondaire dans lequel un enseignement supérieur aurait pu s’enraciner.
Les institutions, fournissant un enseignement supérieur, établies avant la guerre incluent l’Ecole française d’enseignement médical pour l’Afrique de l’Ouest, fondée à Dakar en 1918, l’Ecole William Pontee établie à Gorée en 1903 qui dispensait un certain enseignement en matière de médecine et formait des enseignants, comprenait une école d’ingénieurs nautiques ainsi qu’une école de médecine vétérinaire, respectivement à Gorée et à Bamako, et une école polytechnique également à Bamako.
Ce n’est qu’à la fin de la 2ème Guerre Mondiale que des efforts plus systématiques ont été entrepris par les gouvernements coloniaux afin d’établir un système d’enseignement supérieur. Dans les colonies britanniques, l’ère nouvelle a commencé avec la fondation d’université au Nigeria (Ibadan 1947), Ghana (Legon 1948), Soudan (Khartoum 1949 qui est le résultat de la fusion du Gordon Memorial College et de la Kitchener Medical School) et en Ouganda, Makerere dont le niveau a été rehaussé en 1949.
Par ailleurs, au Kenya, le Royal Technical College a été établi à Nairobi, cependant, que plus au sud le University College of Salisbury a été fondé en 1953 et renommé deux ans plus tard le University College of Rhodesia and Nyasaland. Fourah Bay College est devenue University College de la Sierra Leone.. La plupart de ces nouvelles universités ou d’institutions améliorées ont servi d’universités régionales, affiliées à l’université de Londres dont provenaient les diplômes et autres crédits académiques
Après la guerre, les universités françaises ont aussi essaimé vers les colonies. Ainsi l’université de Paris a établi un institut d’enseignement supérieur à Tunis en 1945, et conjointement avec l’université de Bordeaux, un autre à Dakar en 1950, devenu l’université de Dakar en 1957, et à Antananarivo en 1955 – devenu l’université d’Antananarivo en 1960. En Algérie, l’accès à l’université d’Alger a été légèrement assoupli pour les Algériens. Toutefois au moment de la révolution en 1952, il n’y avait guère plus de 1000 Algériens diplômés de cette université. Dans le reste de l’empire français, l’enseignement supérieur a dû attendre l’indépendance pour prendre son essor.
Les Belges au Congo ont adopté la politique française et l’Université Catholique de Louvain a établi le Centre universitaire de Lovanium (Petit Louvain) en 1949 avec lequel elle a maintenu une filiation en 1954, cependant que l’Etat fondait l’université officielle à Lubumbashi. Lovanium recevait également des étudiants du Rwanda et du Burundi.
Dans les colonies portugaises l’enseignement supérieur n’as guère évolué jusqu’au début des années 60. En Angola des séminaires pour la formation des prêtres ont été mis sur pied en 1958 à Luanda et à Huambo, suivis de l’établissement d’universités générales en Angola et au Mozambique comme branche du système universitaire portugais, lesquelles ont été converties en 1968, respectivement en l’université d’Angola et l’université de Lourenço Marques.
Au cours de cette période, le régime d’Apartheid fût établi en Afrique du Sud en 1948 avec pour corollaire le déni de l’enseignement supérieur sur des bases de ségrégation raciale. La population noire ne pouvait plus suivre les cours d’une université « blanche » à moins d’une autorisation spéciale du gouvernement et des universités séparées furent créées à l’intention des Africains dans les territoires autonomes ainsi que dans les villes principales pour les « Colorés » et les « Indiens ».
En 1994, l’année de l’avènement de la démocratie dans le pays et du premier gouvernement élu, il y avait 36 institutions dispensant un enseignement supérieur dont 21 universités et 15 technicum, desquels 19 étaient réservés aux Blancs, 2 aux « Colorés », 2 pour les Indiens et 13 pour les Africains. Inutile de dire que les ressources allouées à l’enseignement supérieur destiné aux Blancs étaient beaucoup plus importantes que celles pour les écoles fréquentées par les autres « races », les Africains obtenant la part la moindre.
En Namibie, pays sous occupation sud-africaine depuis la fin de la 1ère guerre mondiale jusqu’à l’indépendance en 1990, l’enseignement supérieur n’a été disponible qu’à partir de 1980 avec la fondation de l’Academy for Tertiary Education, suivie par la création du Technicum de Namibie ainsi que le College for Out-Of-School Training.
La décolonisation a été un processus échelonné qui a vu les pays africains accéder à l’indépendance à des périodes différentes. Mais la majorité d’entre eux y a accédé dans les années 50 et 60. La période coloniale n’a laissé que peu d’université et la majorité des pays n’en n'avait pas une seule, tant et si bien qu’un des principaux défis auquel les nouveaux Etats ont été confrontés, a été la mise sur pied ou le développement d’un système d’enseignement supérieur.
De plus, et compte tenu que les rares universités existantes étaient calquées sur le modèle européen et plutôt élitistes, il a été nécessaire de les adapter aux besoins du développement de l’Afrique et à son contexte socioculturel afin de les rendre plus accessibles aux étudiants de provenance sociale diverse.
A travers toute l’Afrique, la croissance du système d’enseignement supérieur après l’indépendance a été phénoménale. Les nouveaux Etats ont entrepris d’ambitieux projets de développement de leur système d’enseignement supérieur dans lesquels les universités jouent un rôle prépondérant dans la formation d’une force de travail hautement qualifiée, créant et reproduisant une élite nationale qui rehausserait le prestige national. Les modèles et structures des nouvelles universités nationales étaient divers et flexibles.
Dans l’ensemble, elles étaient beaucoup plus importantes que les universités qui les ont précédées, avec une mission de plus grande envergure et une multiplication des disciplines et programmes à disposition, offre qui allait de l’art aux sciences sociales sans omettre la médecine, l’économie et l’enseignement technique. Ces universités offraient également un enseignement post-grade.
En 1960, l’année où la plupart des pays africains ont acquis l’indépendance, le nombre des étudiants enrôlés dans les universités africaines était estimé à 120 000 ; ce chiffre a bondi pour atteindre 782 503 en 1975 et 3 461 822 en 1995 pour se situer probablement autour des 5 millions au jour d’aujourd’hui. Egalement, le nombre des universités est passé de moins de trois douzaines en 1969 à plus de 400 en 1995 et plusieurs centaines d’autres se sont peut-être ajoutées à ce nombre depuis l’émergence et la prolifération des universités privées.
Aujourd’hui l’enseignement tertiaire existe dans toute l’Afrique même si les systèmes diffèrent énormément en terme de dimension, de degré de développement et de différenciation interne. Par exemple, en 1995 la plus forte concentration d’étudiants universitaires était en Egypte (850051), suivie par l’Afrique du Sud (617 897), Nigeria (404 969) Algérie (347 410) et du Maroc (294 502) (Banque Mondiale 2000 :11). Ceci en contraste avec 23 autres pays avec moins de 10 000 étudiants à l’université.
On remarque des différences importantes en terme de genre dans l’accès à l’enseignement supérieur. Cependant que plusieurs pays ont réussi à atteindre la parité des genres pour l’accès à l’enseignement primaire et secondaire, rares sont ceux qui ont atteint cette parité en ce qui concerne l’enseignement tertiaire. Seuls le Botswana, le Lesotho, le Swaziland, la Namibie et l’Afrique du Sud y sont parvenus.
Le fossé entre les genres est également manifeste du point de vue des disciplines et des facultés. Les femmes se concentrent sur les humanités et les sciences sociales et sont grandement sous représentées dans le domaine des sciences et des formations professionnelles.
En tant que sociétés stratifiées, parfois multiethniques, multiraciales, l’accès à l’université dans les pays africains est de surcroît filtré selon des critères ethniques, raciaux, de classe sociale et parfois, selon des critères religieux ou d’affiliation culturelle.
Après l’indépendance, l’appartenance à une classe sociale est graduellement devenu un élément déterminant du fait de la croissance rapide d’une classe moyenne et ce, dans une bonne mesure, grâce à l’établissement ou à l’extension de l’enseignement supérieur.
L’extension massive de l’enseignement sur tout le continent n’a pas seulement contribué à une amélioration des ressources humaines africaines, mais a également contribué à l’expansion des capacités intellectuelles et communautaires de l’Afrique. Néanmoins l’Afrique demeure le continent où l’enseignement tertiaire est le moins répandu avec moins de 5% d’inscription dans les universités, cependant que les pays pauvres et moyennement pauvres enregistre 10% et les pays riches 58%.
Dans les années 80 et 90, les pays africains ont dû affronter des défis additionnels dans le domaine de l’enseignement supérieur en raison des ajustements structurels draconiens réclamés par les institutions financières internationales, parmi lesquelles la Banque Mondiale. Les réductions budgétaires subséquentes ont affecté les dépenses sociales, y inclus l’enseignement et plus particulièrement l’enseignement supérieur, ce dernier étant estimé par les néo-libéraux d’être d’un bénéfice moindre que l’enseignement primaire.
Ainsi, dès les années 80, alors que le nombre de collèges et d’universités était toujours entrain de croître, il devint de plus en plus apparent que le système d’enseignement supérieur dans nombres de pays était en crise, ce qui s’est manifesté par une diminution de la contribution financière étatique et du niveau d’enseignement, de bibliothèques et de laboratoires sous-équipés, des réductions de salaire et la démoralisation des enseignants.
Le personnel académique s’est de plus en plus orienté vers des fonctions de consultants à moins qu’il ne participe à « l’exode des cerveaux » en s’engageant dans d’autres secteurs d’activité, dans leur pays ou à l’étranger. Les conséquences, pourtant prévisibles, ont été que l’enseignement et la recherche ont payé un lourd tribut sans parler de l’impact fâcheux sur la capacité africaine à produire des ressources humaines hautement qualifiées.
En réaction à la crise engendrée par un exode académique croissant, ont surgi des réseaux de recherche régionaux qui ont véritablement proliféré. Le secteur d’ONG à caractères académiques s’est également étoffé. On citera le « Council for the Development of Social Science Research in Africa » (CODESRIA) basé à Dakar ainsi que l’ « International Institute for Insect Physiology and Ecology » (ICIPE) à Nairobi. Ces organisations ont fourni un soutien crucial dans le domaine de la recherche fondamentale et appliquée, aussi bien à des individus que dans le cadre de projet de coopération, en offrant de la formation, des postes d’interne et des bourses à des étudiants post-grade.
L’explosion du nombre d’universités privées, la privatisation des programmes et des sources de financements des universités publiques est non seulement la conséquence de la perte de la manne étatique mais également de la libéralisation de l’enseignement supérieur en Afrique. Les universités privées se distinguent par des traits institutionnels typiques (leur statut- à but lucratif ou non ; identité –religieuse ou séculaire ; leur focalisation, business, musulman ou chrétien), par leurs programmes et leur niveau, leurs ressources humaines et financières, leurs structures institutionnelles et leur règle.
Bien que ces universités aient eu à faire face à d’énormes défis, au début de l’an 2000 elles ont commencé, dans certains pays, à devenir plus nombreuses que les universités publiques, une évolution qui a profondément et pour toujours altéré le terrain de l’enseignement supérieur en Afrique.
Dès la fin des années 90, les chefs africains, les éducateurs, chercheurs ainsi que les donateurs extérieurs ont graduellement pris conscience du défi devant lequel l’enseignement supérieur africain se trouvait et du besoin de renouveau si le continent devait atteindre un plus fort taux de croissance et de développement et pouvoir entrer dans la concurrence dans le cadre d’une économie globale de plus en plus axée sur des savoirs pointus.
Un programme de réforme comprenant cinq grands thèmes a été établi pour lequel, au-delà du discours, il n’y a guère eu d’allocation de ressources adéquates.
Premièrement le besoin d’examiner systématiquement le fondement philosophique des universités africaines a été reconnu. Y sont incluses des considérations sur la question des principes qui sous-tendent l’enseignement supérieur public dans une ère de privatisation ainsi que la question de la conception, du contenu et des conséquences des réformes actuellement entreprises sur tout le continent. L’interface entre le secteur public et privé dans le domaine de l’enseignement supérieur fait également partie des thèmes abordés.
Le deuxième groupe de thèmes concerne la question de l’administration qui est également un terrain difficiles: contrôle de qualité, financement, gouvernance et gestion face à de nouveaux règlements, à une pression croissante pour la recherche de financement alternatif, d’une démographie changeante et de la culture des masses, d’une demande accrue d’accès et de parité pour des groupes sous représentés, en particulier les femmes, l’émergence de nouvelles formes de politique estudiantine et académique alors que la démocratisation gagne du terrain.
Troisièmement, il y a la question conceptuelle et pédagogique qui va de la question de la langue d’enseignement dans des universités africaines et dans le système scolaire dans son entier à la dynamique de la production du savoir- la pertinence sociétale du savoir produit par le système d’enseignement supérieur africain, la diffusion de ce savoir et sa « consommation » par les étudiants, la communauté académique et le grand public.
Quatrièmement, le rôle des universités dans la poursuite du projet nationaliste africain est également examiné, à savoir : la décolonisation, le développement, la démocratisation, la construction de la nation et l’intégration régionale. Par ailleurs, les relations inégales et changeantes entre les universités et l’Etat, la société civile et l’industrie ainsi que le rôle de l’université dans la gestion et la résolution des diverses crises qui confrontent le continent africain, des guerres civiles aux épidémies y compris le VIH/SIDA, font partie du débat.
Le rôle que les universités africaines ont joué et peuvent jouer dans le futur dans la promotion ou le torpillage du projet panafricain est d’un grand intérêt au moment où les Etats africains, au travers de l’Union africaine, font de nouveaux efforts pour réaliser une coopération plus étroite des Etats africains entre eux ainsi qu’entre l’Afrique et les diasporas.
Enfin, il y a lieu d’aborder la question de la globalisation et d’examiner l’impact des tendances associées aux nouvelles technologies de l’information et de la communication, l’expansion de l’enseignement supérieur par-delà les frontières et les nations ainsi que le commerce de services d’enseignement tel que prévu dans les accords du GATS (General Agreement on Trade in Services). Dans ce contexte, le rôle changeant des donateurs extérieurs est critique, qu’il s’agisse de fondation philanthropique ou de la Banque Mondiale, d’institutions financières ou de services multilatéraux. L’impact de ces tendances sur l’enseignement supérieur africain- et inversement- est de la plus haute importance et fournit une aire de collaboration fructueuse entre les chercheurs africains et ceux d’autres régions du monde.
Les défis auxquels les universités africaines ont à faire face sont sérieux et inquiétants. Mais l’enseignement supérieur africain a une longue histoire et aura un long futur. La responsabilité pour assurer ce futur productif incombe d’abord aux chefs africains, aux éducateurs et aux académiques qui ne peuvent se permettre de se complaire dans un afro pessimisme morbide.
* Paul Tiyambe Zeleza est Professeur d'Etudes Africaines et d'Histoire, Pennsylvania State University. Il est l'auteur de plus de 20 livres et lauréat du Noma Award en 1994 et de la Récompense Spéciale en 1998 du Noma Award pour deux de ses livres. Cet article a été publié pour la première fois sur http//zeleza.com, le site web de l’auteur qui a gracieusement permis sa reproduction par Pambazuka News.
* Cet article a d'abord paru dansl'édition anglaise de Pambazuka News n° 263. Voir :
* Vos commentaires peuvent être envoyés à [email protected] ou commentez en ligne sur : www.pamabazuka.org
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 1758 lectures