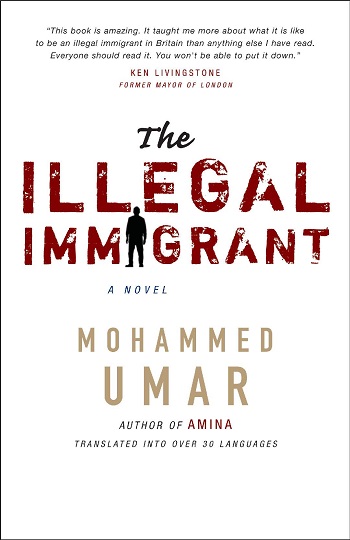C’est une monumentale erreur des chercheurs de ne pas désagréger les expériences des jeunes Africains, de ne pas les distinguer de la cohorte plus générale des Noirs, compte tenu de ce que nous savons sur les différents modèles de migration de la diaspora au Canada.
Cet essai débute par petits bouts. C’est une tentative pour rassembler les réalités et les expériences d’un groupe qui, jusqu’à un certain point dans l’histoire du Canada, a été insuffisamment théorisé ; la deuxième génération de jeunes Africains immigrés. J’ai des raisons de croire que ceux-ci sont nombreux. Mais avant d’entamer la discussion, il est important de me situer comme une Africaine de deuxième génération qui a passé la majeure partie de sa vie dans le Grand Toronto
Ma famille est arrivée à Toronto en 1998, en provenance du Ghana, en Afrique de l’Ouest, au plus fort de l’effondrement économique. Nous nous sommes installés dans le West End de Toronto, dans un quartier résidentiel habité surtout par des nouveaux arrivants, au milieu de gens venant des Caraïbes, de l’Asie du sud et d’autres communautés africaines.
J’ai été élevée comme une Ghanéenne qui vit au Canada. Nos parents n’ont pas considéré le long terme. Ils n’étaient pas là pour s’intégrer ou pour se créer une identité canadienne. En fait l’identité qu’ils voulaient me donner était distincte de la canadienne et ne reflétait pas tout à fait la société ghanéenne contemporaine. Comme immigrants, ils vivaient dans cette nébuleuse du souvenir du passé tout en apprenant à naviguer dans leur réalité présente.
Dans ce contexte nous avons grandi avec trois cultures distinctes : la culture ghanéenne pratiquée à la maison et dans le cadre du réseau social, mon voisinage immédiat qui était à prédominance noire de la diaspora et classe ouvrière et enfin la société canadienne dominante comprenant des morceaux de multiculturalisme.
En traversant ces trois mondes, j’ai souvent été confrontée à mon incapacité à entrer dans l’une ou l’autre. J’ai commencé à me demander si d’autres jeunes Africains faisaient la même expérience en grandissant au Canada. Avaient-ils aussi le sentiment d’être délocalisés alors qu’ils naviguaient dans ces mondes ? Etaient-ils complètement acculturés ? Etaient-ils différents ? C’est ainsi que ces questions saillantes m’ont conduit à m’embarquer dans une recherche exploratoire concernant la jeunesse africaine.
J’ai découvert que jusqu’à maintenant la majeure partie des recherches concernant les jeunes Africains a été soumise à d’autres catégories. Par exemple, beaucoup de choses ont été écrites à propos de la nouvelle et la première génération d’immigrants africains, les chercheurs ayant parfois commis l’erreur de supposer que les enfants des immigrants sont confrontés aux mêmes genres de défis concernant l’installation et l’intégration.
En fait, les enfants africains élevés dans la diaspora naviguent souvent dans des réalités socioculturelles très différentes de celles de leurs parents. Le deuxième problème de ces recherches sur la jeunesse africaine est que les jeunes Africains sont souvent amalgamés dans une catégorie générale de "Noirs" dans ce que les chercheurs nomment "l’inflexibilité de la différentiation" (Tettey et Puplampu, 2005). Comme le note Zaami (2012), pendant que les Africains (et d’autres Noirs) immigrants ont les mêmes aspects physiques, "la supposition que leurs expériences et la nature de leur adaptation, et … d’exclusion sociale sont [facilement superposables] est injustifiée".
Par exemple, les jeunes Africains apprennent souvent à naviguer avec l’hyper visibilité caribéenne dans la construction et la présentation de l’identité canadienne noire, compte tenu du fait que l’histoire de la migration des Caraïbes vers le Canada est plus ancienne.
Un autre problème, lorsque l’on parle des jeunes Africains dans le Nord global, est que beaucoup des données sur la deuxième génération proviennent de l’expérience américaine. Toutefois compte tenu des différences politiques culturelles et historiques du Canada, ces données ne sont pas toujours transférables. Avant 1967, Trudeau (Ndlr : ancien Premier ministre du Canada) a institutionnalisé une politique de multiculturalisme qui a introduit des immigrants qualifiés et non qualifiés, l’Etat/nation canadien étant conçu comme un Etat blanc. (Banerjee 2000, Razack 1998, Dei 2005, Whitaker 1991).
Pourtant, aujourd’hui, "cette ancienne nation pour Blanc seulement" est entrain de se noyer dans sa propre rhétorique du multiculturalisme. Toutefois, les recherches de Mensah (2000), Banerjee (2000) et Galabuzi (2001) notent que la majeure partie de cet ethos multiculturel tend à masquer les inégalités structurelles qui marginalisent insidieusement les immigrants de couleur dans les domaines de l’instruction, de l’emploi et du logement. En même temps, on peut avancer que la position multi culturaliste du Canada, ironiquement, ouvre un espace aux jeunes immigrants africains qui leur permet de s’identifier à la culture de leurs parents bien plus que l’assimilation aux Etats-Unis.
En effet, je suggère que comte tenu de ce contexte, il y a un besoin croissant d’articuler et d’étudier les besoins, expériences et défis des immigrants de deuxième génération. Cet essai veut commencer par déballer les façons dont les jeunes Africains expriment et revendiquent une identité dans le contexte canadien.
Mon article se base sur deux questions : la première est de savoir comment les jeunes Africains de la diaspora expriment/négocient leurs identités culturelles dans une société multiculturelle comme le Canada. La deuxième est : que nous disent ces narrations concernant la nature changeante "du Canada noir" et les identités africaines globalisées ? L’article se terminera avec une courte réflexion sur les progrès à faire dans le domaine embryonnaire des études sur la nouvelle diaspora africaine. Déjà, cet article commence à offrir un certain aperçu sur le potentiel et la qualité de vie des jeunes Africains vivant dans le Nord global.
ACCULTURATION ET LA CONSTRUCTION DES COMMUNAUTES
Que savons-nous des jeunes Africains au Canada ? Les recherches menées au cours de la décennie écoulée suggèrent que les jeunes Africains apprennent à construire un sens de la communauté au sein de leurs groupes ethniques et dans la société canadienne plus généralement. Comme pour la plupart des immigrants, les Africains s’engagent dans la construction de communautés au Canada parce que c’est souvent vital pour leur réussite économique et sociale au cours de la période d’installation. (Yeusfu, 2009, Wong 2005, Creese 2011).
En particulier pour les parents immigrants dans de plus petites villes ou dans des communautés moins diverses, adopter une identité panafricaine devient une stratégie politique qui porte ses propres bénéfices. (Creese 2011) Surtout, parmi ces bénéfices, il y a la possibilité de transmettre et d’absorber la culture des parents. Par exemple, Creese (2011) trouve que dans la communauté d’immigrants relativement restreinte de Vancouver, les membres s’engagent dans une série de pratiques et d’activités pour construire une communauté pour la deuxième génération, y compris un club de foot, des sociétés de musique, des organisations communautaires et des centres culturelles et une fédération d’organisations africaines.
Chose intéressante, les parents expriment souvent le souhait de contrebalancer ce qu’ils perçoivent comme "l’influence négative de la culture populaire afro-américaine" (Creese 2011) Les membres de la communauté de Vancouver enseignent à leurs enfants ce qu’ils croient être les quatre grandes valeurs africaines : "le respect des aînés, le respect de l’autorité du père et du mari, la solidarité communautaire et la sacralité de la vie" (Creese 2011). En effet, la littérature suggère que les compétences des enfants pour fonder une communauté dépendent souvent des efforts des parents pour les exposer à des valeurs et croyances culturelles.
Ojo (1997) note aussi l’importance qu’il y a à créer ou imaginer la patrie culturelle, particulièrement dans l’environnement hostile du Canada. Ses travaux examinent comment sa double identité africaine/caribéenne est négociée dans l’espace d’un cours de beauté de Trinidad à Toronto. Elle tire de sa propre expérience, parce qu’elle a grandi au Canada avec un parent africain et suggère que de se connecter à la culture de la patrie de ses parents était une stratégie de survie. Dans son étude des jeunes Afro-canadiens impliqués dans un concours de beauté culturel, elle trouve qu’un tel espace culturel offre aux jeunes la possibilité de se connecter et de construire une communauté au sein de la diaspora.
Souvent, dans le cadre de ces espaces culturels, les jeunes de deuxième génération créent des patries imaginaires qui satisfont aux besoins d’appartenance : une patrie "sans racisme, sexisme patriarcat et classe sociale". (Ojo 1997) Alors que le danger évident consiste à créer une version mythique ou romantique de la patrie telle qu’elle aurait pu être pour leurs parents, les jeunes de la deuxième génération tirent profit de ces espaces culturels et de la reconstruction mentale afin de faire sens de leur propre déracinement au Canada.
D’autres recherches compliquent ces espaces culturels internes, les considérant comme grandement contestés, alors que les jeunes de deuxième génération luttent pour leur faire sens, pour trouver un sens. Dans son groupe d’étude, les réfugiés Oromo Canadiens, Kumsa (2005) trouve que les jeunes Oromo, dont beaucoup sont arrivés au Canada comme réfugiés durant la guerre civile en Ethiopie, naviguent entre trois différentes communautés en ce qui concerne leur appartenance : la communauté nationale canadienne, la diaspora noire en général et les Oromos d’Amérique du Nord.
L’histoire de l’expansionnisme européen en Ethiopie les a marginalisés davantage au sein de la nation, leur mise en minorité s’est accentuée lorsqu’ils ont été stigmatisés par l’étiquette de "réfugiés". Non seulement ces jeunes sont confrontés par altérité dans la société canadienne en général mais ils ont aussi à lutter contre d’autres communautés noires (y compris les migrants éthiopiens), de même qu’au sein de leur propre communauté. En fait, dès lors qu’il est question d’appartenance, on trouve une intéressante division. Confrontés à d’autres différences comme la différence raciale avec les Canadiens blancs et les différences culturelles avec d’autres Noirs, les jeunes Oromos affirment une forte identité culturelle. Toutefois lorsque ces variables disparaissent, les différences internes se magnifient comme celle entre les Oromos américains et les Oromos basés au Canada. Ironiquement, lorsque les deux groupes se rencontrent, ils affirment un fort patriotisme pour leur pays hôte.
Dans une autre étude sur les femmes africaines de deuxième génération à Alberta, Okeke-Ihejirika et Spitzer (2005) soulignent que les jeunes ont une compréhension bien plus flexible de la communauté, qui n’est pas limitée par l’espace et l’endroit. En effet, lorsque ces jeunes parlent de leur "communauté ", ils incluent souvent leur foyer ancestral, leurs réseaux de Noirs de la diaspora et la grande communauté d’Edmonton. De plus, cette étude suggère que les jeunes Africains d’Alberta opèrent comme "un réseau social", parce qu’ils n’interagissent pas avec des Africains sur une base quotidienne mais reposent les uns sur les autres pour trouver force et ressources. Il est vrai que l’une des difficultés dans la transmission de leur notion de communauté à leur famille transnationale provient de leur manque de maîtrise de leurs langues africaines d’origine. Souvent les parents servent de lien ou de pont entre leurs enfants et la patrie. Il s’en suit que les enfants ne peuvent communiquer avec leurs cousins et autres membres de la famille restés au pays qui ne parlent que les dialectes locaux.
Yeboah, (2008) fait également état de la langue comme étant un obstacle principal dans la construction entre les générations dans la diaspora et il avance que le manque de compétences élémentaires dans la langue d’origine va continuer à creuser le fossé entre les générations dans les pays d’accueil. Pourtant, son étude de la jeunesse ghanéenne en Ohio suggère que pendant que certains des enfants ont complètement abandonné le langage parental d’origine, d’autres conservent ce langage mais sont parfois embarrassés par leurs parents qui parlent le Twi en public. Yeboah conclut en disant qu’il "est trop tôt pour dire si les jeunes de la seconde génération rejoindront le classe moyenne américaine dominante ou s’ils vont participer à une sous-classe arc en ciel marginalisée en apprenant l’anglais et en négligeant le Twi"
IDENTITE, LA PRATIQUE DES NOMS ET LA NEGOCIATION DE LA NEGRITUDE
Les défis auxquels sont confrontés les deuxièmes générations dans le système de l’instruction comme discutés plus précédemment, nous fournissent une partie du contexte pour apprécier les points saillants des questions identitaires, de l’appartenance et des pratiques d’auto-désignation. Comme l’ont noté certains auteurs, nos identités sont souvent prédéterminées par des processus sociaux et historiques, des évènements et circonstances passés ainsi que par la configuration contemporaine (Ojo 1997).
Considérant la formation identitaire chez les jeunes Africains aux Etats-Unis, Clark (2008) a découvert que le nombre croissant de communautés africaines dans les métropoles a donné aux jeunes un contexte pour embrasser et se connecter à leurs racines africaines (Clark 2008, Kumsa 2005). Pourtant la recherche suggère aussi que la jeunesse africaine oscille entre l’utilisation d’étiquettes ethniques multiples et les étiquettes raciales pour s’identifier eux-mêmes, ces changements dépendant de leur environnement.
Il est des signes qui suggèrent cependant que certains Africains sont conscients de leurs identités superposées et les adoptent, il y a d’autres jeunes qui résistent consciemment à ce qu’ils voient comme étant une homogénéisation des Noirs, s’identifiant comme Africains ou à leur nationalité respective (Creese 2011, Clark 2008, Yeboah 2008, Okeke-Ihejirika et Spitzer 2005, Ojo 1997).
Pour les jeunes Africains particulièrement, il y a une prise de conscience précoce du racisme anti-noir (Lewis 1992) qui se manifeste par l’exclusion socio-spatiale de la société canadienne dominante et cela même dans un voisinage à racialement marqué. Zaami (2012) note, par exemple, que pour les jeunes Ghanéens dans le corridor de Jane et Finch à Toronto, cette hostilité anti-africaine se manifeste dans leurs difficultés à accéder à un restaurant, des centres commerciaux et des centres récréatifs (à l’intérieur et à l’extérieur de Jane et Finch), dans le profilage racial de la police, les difficultés pour obtenir un permis de conduire, l’isolement dans le lieu de travail et les confrontations avec les employeurs ainsi que la connaissance souvent limitée de l’Afrique et des Africains
Ceci mène souvent à une palette de croyances internalisées concernant son identité culturelle en relation avec la société générale du pays hôte. Pour les jeunes de l’étude de Zaami (2012), ils s’adaptent à l’exclusion par la "reformulation" des codes vestimentaires, l’anglicisation de leur nom sur leur Cv et en cachant leur lieu de résidence. Et pour les jeunes qui arrivent à une étape plus tardive de leur vie, l’idée que l’acceptation croisse avec le temps s’avère parfois erronée, à leur grand chagrin.
Dans son étude des immigrants africains à Vancouver, Creese (2011) trouve que les participants expriment toujours leur ambiguïté concernant leur identité canadienne particulièrement quand ils luttent pour accéder à des ressources étatiques. Même après avoir vécu dans le pays hôte depuis dix ans, certains des participants naviguent sur leur citoyenneté culturelle avec précaution. Par exemple, une citoyenne qui a vécu au Canada pendant plus de treize ans se demande encore à quel point elle se sent canadienne, particulièrement dans les moments où elle ne parvient pas à trouver du travail. Citant la personne, Creese écrit : "Au moment de l’entretien, elle cherchait vainement du travail en relation avec ses qualifications universitaires canadiennes, un processus qui a de nouveau perturbé son identité. Elle a expliqué : "Cette question du travail me donne le sentiment que je n’appartiens pas au Canada. C’est pourquoi je pense : Ok, peut-être que je n’ai pas réalisé que je suis toujours ougandaise" (Creese 2011)
Pour conclure, la littérature actuelle sur les jeunes Africains au Canada est un domaine croissant qui demande à être explorée plus avant. Au final, ces jeunes apprennent à naviguer d’une identité à l’autre dans une société déterminée par la domination blanche. A la différence des enfants issus de l’immigration européenne qui habituellement s’intègre en un temps très court, les jeunes Africains immigrants sont confrontés à la nécessité de s’intégrer dans la configuration sociale du pays hôte qui souvent ne les considèrent pas comme faisant partie intégrante du tissu social du pays hôte (Galabuzi 2000, Ojo 1997, Zaami 2012, Tettey et Puplampu 2005, Khanlou 2008).
J’affirme qu’il est nécessaire d’étendre la recherche à la façon dont les jeunes trouvent leur place dans le contexte d’un Canada très blanc. De plus la dimension du genre des expériences sociales des jeunes Africains a été sous explorée au Canada.
A part l’étude conduite par Okeke-Ihejirika et Spitzer en 2005, dans laquelle ils ont interviewé de jeunes Africaines à Alberta, il n’y a pratiquement pas d’information sur la façon dont la construction sociale du genre influe sur l’identité de ceux qui grandissent au Canada. Le phénomène récent de la migration de retour vers le continent devrait également être exploré dans le contexte canadien. Encore une fois, la majeure partie de la littérature s’est concentrée sur la contribution au développement dans la patrie d’origine, sans prêter assez d’attention à la relation en cours que de nombreux enfants adultes entretiennent avec l’Afrique.
Enfin, il y a besoin de désagréger les données concernant la jeunesse africaine continentale dans la diaspora et autres communautés noires. Alors que je crois en l’utilité d’user de terme comme "noir" afin d’identifier un projet politique particulier ainsi qu’une réalité, il est aussi important de noter que certains organes estiment qu’il n’est pas raisonnable ou suffisant et que "noir" est une étiquette incomplète, parce que "noir" n’a pas un pays dont il provient, une langue qu’il parle, ni une tribu à laquelle il appartient. Mais plus précisément, dans le contexte de la recherche sur la migration, j’affirme que c’est une monumentale erreur des chercheurs de ne pas désagréger les expériences des jeunes Africains, de ne pas les distinguer de la cohorte plus générale des Noirs, compte tenu de ce que nous savons sur les différents modèles de migration de la diaspora au Canada.
CE TEXTE VOUS A ETE PROPOSE PAR PAMBAZUKA NEWS
* Ne vous faites pas seulement offrir Pambazuka ! Devenez un Ami de Pambazuka et faites un don MAINTENANT pour aider à maintenir Pambazuka LIBRE et INDEPENDANT !
http://pambazuka.org/en/friends.php
** Rita Nketiah est une militante féministe panafricaine, coordinatrice pour le Réseau d'action de la communauté noire de Peel.
*** Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur le site de Pambazuka News
**** Les opinions exprimées dans les textes reflètent les points de vue des auteurs et ne sont pas nécessairement celles de la rédaction de Pambazuka News
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 508 lectures