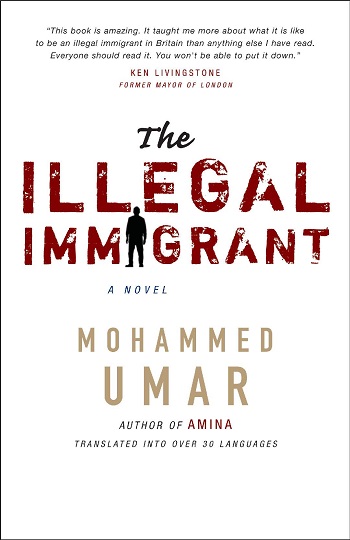L’auteur argumente que l’opposition de l’Afrique à l’adoption des droits des peuples autochtones - qui sont presque toujours des nomades ou des chasseurs et cueilleurs- a été en grande partie informé par des fausses conceptions et des mythes. Il précise que le droit à l’auto-détermination cherché par ces groupes marginalisés a été reconnue par l’Union Africaine comme étant conforme aux principes de l’intégrité territoriale d’un pays.
On est à la fin de juillet 2006. Une visite d’étude et d’information du Groupe de Travail sur les Populations/Communautés Autochtones en Afrique est en cours en Ouganda, l’un des quelques pays africains dont la Constitution se targue d’un régime de droits humains beaucoup orienté vers les droits civils et politiques, de même que les droits économiques et sociaux. La visite, destinée à diffuser les conclusions d’un rapport de 2004 de la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (CADHP) sur la situation des peuples autochtones en Afrique et par conséquent à s’engager dans un dialogue constructif avec les autorités gouvernementales à Kampala ainsi qu’avec les acteurs de la Société Civile, est cependant confrontée à un obstacle insurmontable. Se trouvant à la tête de la délégation ougandaise et chargée de superviser la visite, Rosette Nyirinkindi, chef de la division Union Africaine au sein du ministère ougandais des affaires étrangères, est d’avis que les objectifs de la visite sont contraires à l’esprit de la Constitution Ougandaise, qui cherche, entre autres choses, à renforcer la cohabitation pacifique des communautés de l’Ouganda. Car, d’après Nyirinkindi, diplomate expérimentée qui a jusqu’ici servi à la mission de son pays à New York, la Constitution ougandaise identifie toutes les 56 communautés ethniques résidant dans le pays comme des autochtones, et ainsi mettre à port certaines de ces communautés, et se pencher sur elles à l’exclusion des autres, comme le rapport de l’CADHP l’avait fait, constituait une violation flagrante de l’engagement constitutionnel et politique de l’Ouganda pour l’égalité et un raccourci vers des crises ethniques.
Il s’agit ici d’un scénario classique qui s’oppose au plaidoyer des droits des autochtones en Afrique. Soulever les questions des autochtones sur le continent exige immédiatement que l’on réponde à la question de statut d’autochtone et précisément à qui les droits d’autochtones pourraient être attribués. Ce qui alors ouvrirait la voie à d’innombrables autres interrogations, y compris la question du rôle joué par cette identification dans la promotion des droits humains des bénéficiaires et le lien avec la question d’intégrité nationale. Le présent article va s’attaquer à certaines de ces questions et, on l’espère, donner la voix aux millions d’éleveurs et de communautés vivant dans des forêts qui s’identifient comme des autochtones en Afrique.
Le cadre asymétrique
Il est difficile d’analyser la question de droits des autochtones en Afrique sans y associer la question de statut d’Etat, et il est strictement impossible d’aborder cette dernière sans considérer, comme question de nécessité, ses origines douteuses. L’entreprise coloniale, marquée par la domination et l’annexion du territoire en Afrique, fut téléguidée par Léopold, le monarque belge et Bismarck, Chancelier allemand, et elle atteignit son paroxysme à la Conférence de Berlin en 1884, convoquée manifestement pour réglementer les relations commerciales parmi les diverses puissances européennes. Le résultat fut le morcellement du continent en 53 Etats multiethniques et bizarres sans aucune rationalité scientifique ou sociale à part celle de trancher les territoires parmi les différents colons, un fait qui certainement met de l’eau au moulin au mouvement naissant d’unification de l’Afrique.
En se basant sur la croyance ethnocentrique selon laquelle la morale et les valeurs du colon européen étaient supérieures à celles de l’Africain colonisé, le colonialisme constituait une discrimination raciale évidente liée aux théories pseudo scientifiques étayées dans le sel de la religion chrétienne des 17ème et 18ème siècles. Cette forme de Darwinisme social qui a placé les blancs au sommet du royaume des animaux, «naturellement» portant la responsabilité de dominer les populations autochtones non européennes semble avoir trouvé une justification philosophique forte dans les travaux du philosophe allemand Hegel, entre autres auteurs, qui prétendaient que l’Afrique sub-saharienne était une ancienne utopie qui était restée - à toutes fins de connexion avec le reste du Monde – fermée sur elle-même : «la terre d’enfance, qui s’étendant au-delà de la journée de l’histoire consciente d’elle-même, est enveloppée dans le sombre manteau de la nuit. » Son caractère isolé, soutenait Hegel, a son origine non pas uniquement dans sa nature tropicale, mais essentiellement dans sa condition géographique. Hegel prétendait que les nègres des hautes terres ont continué d’exister dans un état de conscience qu’il a appelé « l’enfance de l’humanité» d’où le concept juridique de découverte qui a inspiré l’ensemble des rapports de propriété coloniale avec les territoires des peuples conquis.
L’Etat post-colonial en Afrique, issu de cet artifice colonial, non enthousiaste à se remodeler et ayant renforcé les frontières coloniales à travers l’ancienne doctrine de droit international d’uti possidetis, est donc caractérisé par des faiblesses qui se sont souvent manifestées en conflits ethniques graves, gouvernance médiocre, les inégalités visibles et la pauvreté chronique. Les droits des autochtones en Afrique doivent donc être évalués et affirmés à partir de ce contexte.
Comme l’écrit Howitz dans «Paradigm Wars» (Guerres de Paradigme), les processus coloniaux de l’acquisition territoriale et la formation des Etats de même que la consolidation post-coloniale des Etats a eu des conséquences dramatiques pour les droits en matière de ressources et les identités des communautés en Afrique: «Les biens, les intérêts et la propriété des peuples autochtones ont été vendus, loués à bail, commercialisés, et spoliés; les communautés ont été dépossédées, déplacées et appauvries; les terres ont été submergées, dégagées, clôturées et dégradées ; les mers, les rivières et les lacs ont été pollués … et appropriés pour usage privé; des sites sacrés ont été dynamités, cassés, profanés et endommagés de toutes manières; des connaissances et matières culturelles ont été volées, affichées, appropriées en tant qu’héritage national, et commodifiées comme des biens économiques; et même les peuples autochtones eux-mêmes ont été classifiés, assujettis à une législation répressive, déplacés arbitrairement de leurs familles par des structures des Etats, et plus récemment, assujettis à commercialiser leurs matériels génétiques.»
Droits et peuples autochtones en Afrique
Alors qu’il est indéniable que tout le continent fut ravagé et pillé par l’occident à travers l’esclavage, le colonialisme et le néo-colonialisme, il reste embarrassant que la réalité comme quoi ces forces ont occasionné des désavantages disproportionnés pour certaines communautés en Afrique au détriment des autres et au-delà des autres est en train d’être niée vigoureusement. Pourquoi est-il trop difficile de comprendre que les Maasai qui ont cédé plus d’un demi-million d’hectares de terrain pastoral dans la grande vallée du Rift au Kenya aux Britanniques constitueraient aujourd’hui l’une des communautés les plus pauvres dans le pays ? Est-ce question d’être génie pour comprendre que l’expulsion des Batwa des Parcs nationaux de Bwindi et Mgahinga en Ouganda pour donner la priorité à la protection du gorille de montagne, un objet-clé d’attraction des touristes, a mené à la quasi-décimation de cette communauté de chasseurs et cueilleurs ? Faut-il chercher à savoir ce qui contribue à la pénurie des Herero en Namibie, que les Allemands ont massacrés en masse et dont ils se sont servis comme des cochons d’Inde à l’aube du 19ème siècle ?
La pire partie du cauchemar est que le départ des colons, plutôt que de frayer le chemin à reconstruction de l’ordre politique et économique de l’Afrique, a déclenché une nouvelle série de dominateurs noirs, qui, profitant des instruments et des institutions de l’Etat colonial, ont continué de saccager et de piller les ressources du continent et complètement fermé la porte à la justice restauratrice.
Ignorant l’ignominie du colonialisme et des forces successives, les décideurs en politiques publiques contemporaines en Afrique font une tentative vigoureuse de construire une réalité basée sur l’ « intérêt national » et non sur des dessins communautaires qu’ils considèrent provinciaux et, par conséquent, sectaires. C’est cette classification d’identités et la conflation de la question d’égalité pour tous les gens qui sont en grande partie responsables du déni de droits autochtones.
Car les droits d’autochtones sont considérés comme un domaine de droits qui cherchent à disloquer les priorités nationales pour des finalités communautaires, qui ne rentrent pas dans la logique et le syllogisme du développement étatico-centriques. Le fait que certaines communautés aient refusé ou ignoré d’adapter leurs intérêts aux priorités nationales de développement est vu comme un échec de prendre la responsabilité et les exigences du progrès. Cette objection est l’affirmation classique qui met en cause la pertinence de reconnaître la diversité dans des sociétés divisées, une tendance qui hégémonise l’Etat. Une analyse critique des droits des autochtones et ses bénéficiaires démontrerait cependant l’erreur des dites objections.
Tout d’abord, les droits des autochtones sont basés sur la notion générale d’universalité des droits dans un cadre multiculturel tel que respecté dans la reprise à Viennes du caractère des droits humains en 1993. C’est à partir de Viennes qu’une voix sans équivoque est sortie pour réaffirmer la dignité inhérente et l’unique contribution des autochtones au développement et à la pluralité de la société et lancé un appel à leur inclusion totale dans la vie de l’Etat. C’est par conséquent un anathème de mettre en cause la place des droits des autochtones dans le discours national, car les deux peuvent cohabiter aisément et se soutenir mutuellement ; le premier permettant au second d’attirer davantage de légitimité née de l’inclusion substantive des groupes marginalisés tandis que ce dernier profiterait de l’inclusion dans les processus nationaux. En renforçant l’Etat d’où il serait autrement absent, la promotion des droits des autochtones tels que la gouvernance d’autodétermination et le développement locaux conduirait à une paix positive et anéantirait le recours au conflit.
Deuxièmement, les droits des autochtones doivent être vus comme une facilitation de la véritable égalité, répandant ainsi la lumière à un groupe jusqu’ici non atteint par la prémisse transformatrice de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme. Alors que des sièges de non-discriminations exaltés comme jus cogens, la réalité qu’il reste difficile d’atteindre l’égalité pour tous sur le plan de la Déclaration Universelle exige que les groupes marginalisés, que ce soit des femmes, les enfants, les minorités et les groupes indigènes, poursuivent des stratégies qui vont au-delà de l’égalité formelle pour réaliser la promesse de dignité pour tous les gens. Certains ont donc mis en doute l’efficacité des dispositions de non-discrimination en tant que rempart contre les lacunes de droits humains auxquels font face les groupes autochtones. Le professeur Kingsbury de l’Université de New York a par exemple soutenu que les mécanismes existants ont complètement échoué quant à répondre adéquatement aux préoccupations des groupes autochtones et n’ont par conséquent servi que pour des objectifs symboliques et didactiques, delà la demande de mécanismes plus spécifiques.
Troisièmement, la conception collective des droits a souvent semblé être un enfant d’un dieu moins important au sein de la contestation des droits humains qui a historiquement opposé les droits civils et politiques aux droits économiques, sociaux et culturels. Les droits collectifs, qui sont centraux à la lutte des autochtones partout dans le monde, ont donc souffert d’une prémisse mal exprimée, qui leur a souvent dépouillé de sa normalité normative. Grâce à l’article 27 de la Pacte International Relatif aux Droits Civils et Politiques (ICCPR en sigle anglaise) et la jurisprudence progressive qui est sortie du comité des Droits de l’Homme sur cet article, il a été un terrain suffisant pour la protection des droits fonciers et des droits au développement des groupes, entre autres choses. La bonne liste des droits de solidarité énoncés sous la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, qui peuvent bien s’apprêter à cause des autochtones, est l’œuvre de Keba M’ Baye, juriste sénégalais, dont l’évaluation de la dynamique de la société africaine a inspiré le document. Dans sa monographie sur les droits au développement « Le Droit du Développement comme un Droit de l’Homme » en 1972, M’Baye, empruntant beaucoup de Karel Vasak, directeur de l’UNESCO, articule les droits de solidarité pour inclure le droit au développement, le droit à la paix, le droit à l’environnement, le droit à la propriété de l’héritage commun de l’humanité, et le droit à la communication.
Ainsi la notion d’autochtones et de leurs droits en Afrique doit être comprise non pas uniquement sur base de ses racines étymologiques et textuelles qui mettent l’accent sur l’autochtonie. C’est l’interprétation analytique moderne du terme « peuples autochtones », avec son accent sur l’expérience vécue la marginalisation systémique, de la discrimination, la différence culturelle et l’auto-identification, qui devrait être considérée en ordre par rapport à la pratique émergeante de l’CADHP. Le Groupe de Travail International sur les Affaires Indigènes (IWGIA en sigle anglais) a soutenu que, «la question des autochtones tourne autour de l’affirmation selon laquelle certains groupes marginalisés sont discriminés de manières particulières à cause de leurs cultures particulières du mode de production et de la position de subordonnés au sein de l’Etat et du fait que les cadres juridiques et politiques de l’Etat ont été impuissants pour lever ces défis. Ceci est une forme de discrimination dont les autres groupes au sein de l’Etat ne souffrent pas. Il est légitime pour ces groupes marginalisés d’en appeler à la protection de leurs droits afin d’alléger cette forme particulière de discrimination». Pourtant, c’est aussi à ce niveau d’abstraction que la notion d’autochtones en Afrique s’amalgame avec le concept de droits des minorités, une autre expression problématique mais moins controversée sur le continent.
Cependant, ce sont des fausses conceptions et des mythes qui ont en grande partie influencé la position de l’Afrique en s’opposant à l’adoption des mécanismes de fixation de principes et des normes pour les peuples autochtones. L’année dernière, une attaque dirigée par la Namibie et le Botswana sous le Groupe Africain chargé du Projet de Déclaration sur les Droits des Peuples Autochtones a amené l’Assemblée Générale de l’ONU à reporter la prise de décision sur la déclaration, tenant ainsi en otage la reconnaissance substantive par le droit international des droits des autochtones. Et quand l’Assemblée des Chefs d’Etats et de Gouvernements de l’UA s’est tenue au début de cette armée à Addis-Abeba, ils ont justifié la position du Groupe Africain en se basant sur le fait que les droits des autochtones tels que détaillés dans la déclaration auraient un impact sur l’intégrité territoriale. La question qui dérange beaucoup de gens est celle de savoir si les Batwa en Ouganda, les Endorois au Kenya ou les Bushmen au Botswana ont ou non des plans de créer leurs propres Etats distincts. N’est-il pas évident que le droit à l’auto-détermination recherché par ces groupes est celui qui peut les habiliter et mener à la reconnaissance et à la participation accrue aux affaires publiques ? Une telle tentative serait consistante avec la jurisprudence de la Commission de l’Union Africaine proposée en 1976 dans la communication Katanga contre le Zaïre, qui a établi qu’une variante d’auto-détermination qui garantit l’inclusion des groupes marginalisés au sein d’un Etat est consistante avec le principe d’intégrité territoriale. Ceci était la position réitérée presque vingt ans plus tard dans la décision Ogoni contre le Nigeria de l’CADHP.
Le terme «autochtones» devrait par conséquent revêtir une forme utilitaire constituant une tentative d’attirer l’attention sur la forme particulière de discrimination, et d’alléger cette forme dont souffrent les communautés qui, presque toujours, sont nomades ou groupes chasseurs dans le contexte africain. En s’identifiant au terme, il y a un sentiment comme quoi les particularités de leurs souffrances sont articulées de façon plus approfondie et peuvent s’apprêter à la protection de la loi internationale des droits humains et aux normes morales.
L’adoption d’une liasse flexible de droits qui sont attribuables aux groupes autochtones, plutôt qu’une guerre perpétuelle autour d’un accord unanime sur la terminologie, qui en tout cas a été irréalisable durant les débats des deux dernières décennies sur les droits des autochtones au niveau de l’ONU, me semble offrir la véritable possibilité de reconnaître les droits des peuples autochtones en Afrique.
Un cri dans l’obscurité: vivre en marge de la société
Il est indiscutable que les groupes qui s’identifient comme autochtones mènent une vie de marginalisés, un coefficient de négligence ou d’abus ouvert. La plupart de gouvernements en Afrique n’ont pas de données ou indicateurs spécifiques sur les niveaux sociaux, économiques et politiques des autochtones. Comment peuvent-ils donc suivre de près les progrès vers les objectifs de développement du millénaire (ODM) si les plus pauvres des pauvres ne sont pas adéquatement reconnus? Une question majeure de préoccupation est que beaucoup d’Etats vont mettre l’accent sur le résultat final d’atteindre les ODM, plutôt que le dossier de qui les atteint ou comment. Ce risque fut noté dans le Rapport de Développement Humains 2003 « Les Objectifs de Développement du Millénaire : Un compact parmi les nations pour mettre fin à la pauvreté humaine».
Prenez l’exemple des Twa du Burundi, au Rwanda, au Congo et en Ouganda. Leur mode de vie et les progrès du déboisement les ont poussés à se déplacer pendant des décennies, les laissant vulnérables – tombant entre les dents d’un système social et juridique moderne, qui normalement préserverait la propriété tant de leurs terres que de leurs biens de subsistance. Avec le besoin croissant de préserver les quelques forêts tropicales dans les pays les plus densément peuplés de la région des Grands Lacs d’Afrique, ils se retrouvent exclus de leurs habitats traditionnels.
Étant donné la nécessité de plus de politiques protectrices de conservation, la croissance de l’industrie touristique et les préoccupations en matière de sécurité le long de la frontière avec le Congo, le Burundi et l’Ouganda, par exemple, l’Etat rwandais a pendant des décennies renforcé le contrôle des Zones forestières. Les Batwa ont été les plus affectés par ces mesures, qui les ont déracinés de leur mode de vie traditionnel et de leurs moyens de subsistance et ils ont été incapables de réussir à passer une transition vers une vie sédentaire et une économie du marché.
À cause de leur marginalisation traditionnel et d’un cadre juridique et politique défectueux, la plupart de communautés d’autochtones y compris les Twa n’ont jamais été compensés lorsqu’ils ont été chassés des « Zones protégées » ou des « réserves de l’Etat » où ils étaient habitués à vivre et ainsi leurs conditions de vie se sont détériorées davantage. Aujourd’hui la plupart de Batwa mènent une vie de pauvreté choquante et un rapport récent du Programme des Peuples Forestiers, une organisation caritative britannique, prédit que les Twa sont en danger d’extinction, à moins qu’une action d’envergure et concertée ne soit entreprise pour renverser leur déclin.
Tel est l’état de beaucoup d’autres groupes d’autochtones aussi bien d’éleveurs que de chasseurs, des Barabaig de la Tanzanie aux Tuaregs du Mali.
La voie la moins empruntée
Les droits des autochtones, évités par les politiciens du continent, ont trouvé de la place chez le quatrième pouvoir moins sûre – le pouvoir judiciaire. Avec la réputation d’être incorrigiblement corrompus et inefficaces, les chargés de justice du continent ont toujours à se faire reconnaître comme bastions de la justice pour le pauvre. Pourtant c’est ici que la lutte de reconnaissance et le respect des droits des autochtones a été le plus menée. Du Botswana au Kenya, et de l’Afrique du Sud à l’Ouganda, les cours sont devenues le théâtre de dramatisation de la souffrance des droits des autochtones et l’étendue grave de leur destitution. Au Kenya, une chèvre édentée a été produite comme élément de preuve pour persuader une cour de l’allégation de génocide environnemental perpétré contre la communauté IL Chamus tandis qu’au Botwana, de centaines de membres de la communauté Basarwa ont supporté 200 jours d’audience étant vêtus de leurs costumes traditionnels éclatants pour démontrer qu’ils constituaient en effet un groupe identifiable contrairement aux affirmations de l’Etat. Les audiences judiciaires ont donc été utilisées, avec des effets divers, pour entre autres choses, réclamer la restitution de terres à un groupe d’autochtones en Afrique du Sud ; mettre fin au déplacement par l’Etat des Ogiek au Kenya de la forêt Tinet dans la Vallée du Rift ; pour offrir des services sociaux aux Benet en Ouganda ; pour empêcher une société multinationale d’exploitation minière d’obtenir une concession de terres dans la région de Magadi au pays des Maasai pour la production de cendre de soude; et pour garantir les droits linguistiques en Namibie.
Chose décevante, comme à l’époque de Brown contre le Conseil de l’Education au plus chaud du mouvement des droits civils aux Etats-Unis lorsque la Cour Suprême a publié des jugements en faveur de la déségrégation mais où les Etats racistes et belligérants ont refusé de les mettre en œuvre, les gouvernements africains n’ont pas été enthousiastes à accueillir à bras ouverts les décisions de leurs propres organes judiciaires. Le gouvernement du Botswana, par exemple, a évité la décision de sa Cour constitutionnelle et refusé de permettre aux Basarwa de faire la chasse comme source de revenus au Parc Central de Kalahari, tandis qu’une année plus tard la Cour Constitutionnelle du Kenya a pris la position comme quoi il faudrait créer une circonscription pour la Communauté IL Chamus à Baringo afin d’assurer leur participation aux choix de politiques, aucune mesure n’a été prise. Une situation semblable prévaut en Ouganda où deux ans après qu’un jugement consenti fut adopté garantissant aux Benet de jouir de leurs droits de faire brouter leurs troupeaux sur des terres qu’ils occupent et qu’ils cultivent, aucune mesure administrative appuyant la décision de la cour n’a été prise. Dans un continent qui professe le respect de l’Etat de droit en tant que principe clé dans leur ordre institutionnel, le fait de ne pas parvenir à garantir la mise en œuvre des décisions judiciaires est en effet un acte d’accusation ridicule de l’engagement de l’Afrique à la bonne gouvernance et aux idéaux démocratiques.
Sans découragement, les groupes autochtones ont saisi les mécanismes régionaux pour élaborer des antécédents qui dictent les normes en matière de droits des autochtones. Cependant, leurs tentatives n’ont pas encore produit de résultat. En 2006, la plainte foncière des Bakweri contre le gouvernement camerounais fut perdue lorsque l’CADHP a déclaré la communication inadmissible. Les autochtones en Afrique attendent en retenant leur souffle la décision de la commission en ce qui concerne la communication des Endorois contre le gouvernement kenyan, une communication qui cherche la restitution du territoire ancestral à la communauté autochtone des Endorois.
Et c’est à partir de ces effets dramatiques que les maisons de presse ont tardivement puisé les données et commencé à faire ressortir la folie de non-reconnaissance du malheur des communautés autochtones en Afrique permettant au public Africain et aux décideurs politiques d’examiner leur misère. Les principales organisations de la société civile telles qu’Aide et Action et CARE en Ouganda ont également commencé à réclamer que l’Etat accorde l’attention aux questions de droits des autochtones en tant que moyen de réaliser les questions des objectifs de développement du millénaire. La montée des organisations comme le Centre de Développement des Droits des Minorités au Kenya et le Comité de Coordination des Autochtones d’Afrique en Afrique du Sud, uniquement consacrés à la lutte pour les droits des autochtones en Afrique, est aussi en train de contribuer à rendre visibles ces questions.
La bonne nouvelle, qui est difficile à rencontrer en rapport avec les droits des autochtones sur le continent, est en train d’émerger peu à peu. Les pays comme l’Afrique du Sud et le Cameroun ont pris des mesures claires d’entraver les processus conduisant à ratification de la Convention 169 de L’Organisation Internationale du Travail, convention qui attribue un régime substantif de droits aux peuples autochtones, y compris le droit de consentir librement, préalablement et à bon escient en matière de processus de développement dans les territoires autochtones.
On n’est pas encore sorti d’affaire…
Les luttes des peuples autochtones pour la reconnaissance de leurs droits doivent êtres considérés dans le cadre de la construction des sociétés multiculturelles en Afrique, où les diverses entités contribuent au bien-être de toute l’entité. À moins que ce changement de paradigme ne soit réalisé, les droits des autochtones en Afrique continueront de cumuler des dividendes négatifs en tant qu’instruments de fermeture sur soi et de division. Pourtant pour réaliser ceci, l’Afrique doit maîtriser le défi de sa propre identité. Avant d’y arriver, ce n’est pas encore «uhuru», comme on dit au Kenya, pour les groupes autochtones en Afrique.
* M. Sing’Oei est co-fondateur et directeur du Centre de Développement des Droits des Minoriteés (CEMIRIDE) basé au Kena et au Zimbabwe.
* Veuillez envoyer vos commentaires à ou commentez en ligne sur www.pambazuka.org
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 395 lectures