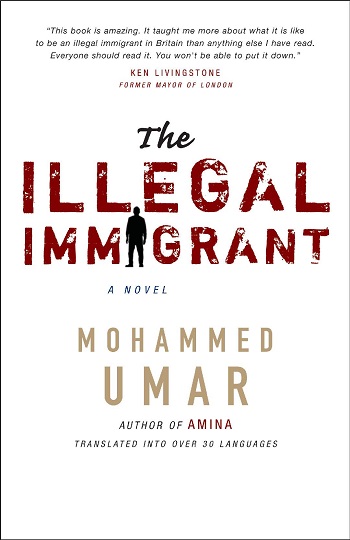Pour Samir Amin, « le véritable objectif de la « science » économique conventionnelle est tout simplement de lui ôter son caractère de science politique, pour la prétendre « neutre, et donc « objective ». Le résultat obtenu est l'annihilation de la capacité critique du citoyen, réduit au statut de spectateur de son histoire”, note-t-il. Et d’interpeller les enseignants des sciences économiques sur ce que devrait être leur approche pour inculquer l’esprit critique à leurs apprenants.
Tout honnête enseignant de Sciences Economiques doit faire étudier l'ouvrage de Rod Hill et Tony Hyatt (The Economics, Anti-Text Book, Zed, 2010) par tous ses étudiants, abreuvés par ailleurs exclusivement des « text books » conventionnels que l'on connaît. L'enseignant honnête est celui qui contribue au développement de l'esprit critique de ses élèves. Il doit leur apprendre la pratique du doute et, pour ce faire, toujours faire discuter les thèses des uns et les contre thèses de leurs adversaires. Faute de quoi, l'enseignant devient un fonctionnaire au service d'une entreprise de lavage de cerveaux. Ce que la majorité d'entre-eux sont déjà, hélas, et souhaitent même être davantage par leur adhésion à la privatisation de la « recherche » qui ferait alors d'eux des salariés (bien rémunérés) de ceux qu'ils servent : le capital des monopoles.
«Anti Text Book» est écrit comme il devait l'être, dans le langage et par les méthodes du discours des « text books ». Il conduit naturellement le lecteur à quelques conclusions majeures dont je ne reprendrai pas le cheminement (lisez le livre tout simplement).
1 - Les Text Books mettent en oeuvre une méthode que refuse la logique la plus élémentaire. Ils ne posent pas la vraie question : le « système » (qualifié de « marché », en fait le capitalisme) existe-t-il parce qu'il est rationnel, ou pour d'autres raisons ? Ils substituent à cette question une réponse décrétée a priori que, puisque le système existe, c'est qu'il est rationnel. Evidemment la question annexe (quelle est la nature et quels sont les limites de cette rationalité décrétée existante ? ) est tout également évacuée au bénéfice d'une réponse formulée à l'avance : il est rationnel du point de vue de la société, elle même réduite à la somme des individus qui la composent.
Les « Text Books » constituent donc des textes religieux fondateurs et rien d'autre. Il faut les croire comme il faut croire le récit biblique (ou dogme) de la création. Au Moyen Age en Europe, en Arabie Saoudite encore aujourd'hui, mettre en doute le texte c'est risquer sa vie. Descartes, en plaçant le doute à l'origine de la pensée critique (la pensée non critique n'est pas une pensée) – sans doute avait-il à l'esprit la remise en question des dogmes religieux de son temps – est ignoré des économistes conventionnels, dogmatiques par l'essence même de leur démarche.
Le « système » imaginé dans les Text Books est donc un système imaginaire (ce que j'ai appelé la substitution d'un « capitalisme imaginaire » au capitalisme de la réalité) tout autant que l'est le (ou les) récit de la création. La réalité n'est pas « l'économie de marché » mais le capitalisme des monopoles . (1)
2 - Dès lors que l'on se pose la question des règles qui régissent le passage du « micro » (la décision rationnelle d'un individu, ou d'une firme) au « macro » (les lois qui régissent le mouvement du système dans son ensemble), on découvre que les théorèmes et leurs corollaires développés pour rendre compte du micro perdent leur validité à l'échelle macro. La société n'est donc pas une somme d'individus et une société imaginée de la sorte ne pourrait pas fonctionner. Je reviendrai sur cette observation centrale.
2. L' « Anti Text Book » démonte les mécanismes par lesquels les Text Books expliquent la rémunération du travail et démontre que les raisonnements mobilisés à cet effet sont pure et simple tautologie. Mais il s'agit là d'une tautologie utile puisqu'elle légitimise l'exploitation de la force de travail qu'elle élimine simplement des questions posées. Je n'ai rien à ajouter à cette démonstration, que j'ai reprise moi même dans mes écrits.
L' « Anti Text Book » montre également que les raisonnements fondamentaux des « Text Books » éliminent d'emblée la question épineuse du « coût » pour les uns et du « bénéfice » pour les autres, constitués par la mise en oeuvre des ressources naturelles de la Planète dans tout processus réel de production. L'ouvrage va plus loin : il démontre que les propositions d'intégrer les externalités dans le calcul économique conventionnel dit rationnel ne sont que des subterfuges, dont l'efficacité dans leur mise en oeuvre reste, pour le moins qu'on puisse dire, discutable. Mais ces subterfuges sont néanmoins fort utiles, parce qu'ils permettent au capital des monopoles de « s'habiller en vert », de récupérer le discours écologique et de s'ouvrir de surcroît un champ nouveau pour son expansion destructrice. Ici aussi je n'ai rien à ajouter à cette démonstration, que j'ai tout également reprise . (2)
Une conclusion s'impose : les « Text Books », comme tous les textes dogmatiques, ne sont pas destinés à former des esprits critiques, mais à lessiver les cerveaux. Bien que je sois personnellement réfractaire à l'usage du terme de « totalitarisme » - qui veut tout dire et rien dire à la fois – je ne vois pas pourquoi ceux qui usent et abusent de ce type de condamnation qu'ils adressent à certains discours en excuseraient le discours de l'économie conventionnelle.
Je ne recommenderai pas moins la lecture complémentaire du livre de Ha-Joon Chang, « 23 things they don't tell you about Capitalism » (Allen Lane, 2010).
L'auteur met en oeuvre un autre langage. Il s'adresse, lui, non aux étudiants de sciences économiques mais au grand public. Dans une forme et un style parfaitement adaptés à son objectif, l'auteur formule 23 parmi les « idées » les plus généralement largement admises par « l'opinion générale », reprises ad nauseum par les médias. Il démontre dans chacun de ces 23 cas que ces idées sont fausses, démenties dans les faits et faibles par manque de rigueur de leur démonstration fallacieuse.
Pourquoi donc se livrer à un tel exercice si la lecture des commentaires de Chang doit convaincre immédiatement de la justesse des critiques ? En réalité cet exercice est fort utile, parce que les idées reçues et propagés par les médias sont, hélas, dominantes, admises non seulement par les défenseurs du système, mais également par beaucoup (sans doute la majorité) de ses critiques.
J'attirerai l'attention en particulier sur la question 22 formulée ainsi, en anglais : « financial markets need to become less, not more efficient ». Chang démontre que la « rationalité » de l'efficacité des inventions du système de crédit contemporain non seulement n'est utile que pour les spéculateurs dont elles ont assuré la fortune (mais aussi, bien que marginalement, le risque d'affronter quelques faillites retentissantes mais sans lendemain pour eux, puisque leurs victimes ont été blanchies et requinquées par l'argent public du contribuable), mais qu'elle est destructrice pour l'économie (donc irrationnelle pour la société).
Les auteurs des deux ouvrages auraient pu aller plus loin qu'ils ne l'ont fait. Mais ils ont décidé de s'arrêter à ce qu'ils voulaient démontrer : que les théories enseignées aux économistes débutants et les idées propagées dans la société concernant l'économie étaient fausses et n'avaient rien à voir avec la réalité dont elles prétendent fournir une analyse. Et leurs superbes démonstrations auraient peut être perdu de leur force de conviction s'ils étaient allés plus loin. Ils voulaient semer le doute. Ils y sont parvenus.
Cela n'exclut pas qu'il soit nécessaire d'aller plus loin.
Les chapitres 7 et 8 que les auteurs de l' « Anti Text Books » consacrent aux externalités et aux rémunérations des facteurs de production (au pluriel) auraient pu être développés davantage. Ces développements auraient alors démontré que l'économie conventionnelle en question (en l'occurrence son marginalisme fondamental) dissocie ce qui dans la réalité ne l'est pas – la « productivité des facteurs de la production » (au pluriel). Marx ne connaissait pas ces « raisonnements à la marge » qui ont été inventés après lui, pour leur porter la contradiction. Mais il en avait par avance démoli la consistance dans la critique fondamentale qu'il fait de ses prédécesseurs, aussi bien des économistes sérieux (Smith, Ricardo) qu'il privilégie dans sa « Critique de l'économie politique » (sous titre du Capital) que des économistes vulgaires de son temps (Say et autres). Il n'y a qu'une seule productivité – celle du travail social mettant en oeuvre des équipements que la connaissance technologique permet d'inventer et de produire, dans le cadre de conditions naturelles données. L'économie conventionnelle, comme la théologie scolastique, dissocie le « corps » et « l'âme » . (3)
Les deux chapitres auraient donc pu conclure que la loi qui commande l'accumulation du capital détruit les deux fondements de la richesse des sociétés : l'être humain réduit à une force de travail marchande, la nature réduite elle aussi au statut de marchandise (ou ignorée). Ils auraient alors redécouvert ce que Marx avait déjà découvert, sans passer par la critique du marginalisme ultérieur. Mais alors ils auraient été amenés à ne plus confondre les concepts de valeur et de richesse, sans laquelle la distinction entre la rationalité relative du capitalisme (commandée et limitée par le rendement maximal, à terme immédiat, du capital) et la rationalité sociale reste impossible à concevoir.
Pour aller plus loin, j'ai choisi de me concentrer sur la critique des recherches fondamentales des deux plus grands économistes positivistes empiristes après Marx : Walras et Sraffa, qui l'un et l'autre veulent démontrer qu'on peut se passer de Marx et néanmoins comprendre comment fonctionne l'économie.
Wahas propose comme on le sait un système d'équations qui décrivent les interdépendances entre tous les prix et les taux de rémunération des facteurs de la production. Mais il échoue à démontrer que ce système, mis en état de fonctionner, « tend vers l'équilibre ». Le système se déplace à déséquilibre en déséquilibre sans jamais tendre vers un équilibre définissable. Walras, qui était honnête, le reconnaît et conclut que l'équilibre n'est possible que si un « commissaire priseur » (ou le parfait uber-rationale comme le qualifient les auteurs des « Anti Text Book », c'est à dire le planificateur du Gosplan idéal) – qui connaît tout (l'anticipation parfaite des économistes contemporains à la dérive) – gouverne le système.
Sraffa propose un autre système dans lequel le salaire disparaît, auquel est substitué la consommation des marchandises achetées par les salariés, et calcule le volume du profit (« surplus ») associé à cette « production de marchandises par le moyen de marchandises ». Il échoue également et ne trouve pas le moyen de définir un étalon stable (et un étalon qui ne le serait pas ne serait pas un étalon) indépendant des salaires, c'est à dire du taux de la plus value (le degré d'exploitation de la force de travail) et des effets du progrès technique sur l'évolution des prix relatifs.
Les deux échecs, sur lesquels je suis revenu, en particulier dans mon dernier ouvrage (La loi de la valeur mondialisée, The law of worldwide value), démontrent que le « détour » par la valeur et la production de la plus value reste incontournable. Mais le reconnaître serait avouer que « l'économique » conventionnelle ne mérite pas d'être qualifiée de « science ».
On ne peut pas comprendre la nature – et donc le fonctionnement – du capitalisme sans quitter la surface visible de la mer agitée par les vagues (le marché) pour plonger dans les profondeurs secrètes du mode de production dans lequel la valeur (et non la richesse) et son partage (la plus value) sont produites. Marx fonde sa critique des plus grands de ses prédécesseurs – Smith et Ricardo qu'il dépasse – en opérant ce transfert du centre de gravité de l'analyse.
Ce n'est pas la voie choisie, après l'échec de Walras et de Sraffa, par les économistes conventionnels contemporains qui, au contraire, s'engagent plus loin dans l'impasse par la fuite en avant dans l'analyse des marchés. Au terme de cette voie sans issue ils inventent le pseudo concept « d'anticipations » des acteurs sur le marché, lesquelles déterminent ses mouvements. Mais la formulation de ces anticipations ne constitue pas un substitut à la découverte des raisons des déséquilibres qui opèrent réellement dans le déploiement de l'histoire du capitalisme. Les anticipations ne font qu'amplifier les mouvements causés en dernière analyse par ces déséquilibres. Keynes l'avait compris. Aucun des prix Nobel d'économie des trente dernières années n'en a été capable. On ne s'étonnera donc pas qu'aucun d'entre eux (mêmes ceux comme Stiglitz qui s'autoproclament « critiques ») n'ait été capable d'entrevoir ce que d'autres (qu'ils ne lisent pas) prévoyaient comme inéluctable. Ces prix Nobel sont l'analogue des prix de la peinture académique, décernés aux seuls producteurs de « croutes ».
Lorsque la question posée est sans pertinence (que sont les anticipations?) la réponse donnée, quelle qu'elle soit, l'est tout autant. J'ai, pour cette raison, qualifié les « recherche » de nos prix Nobel de discussions analogues à celles qui préoccupaient les théologiens du Moyen Age (quel est le sexe des anges?).
La critique du capitalisme reste impuissante tant qu'elle s'arrête à mi chemin. C'est ainsi, par exemple, que Joan Robinson – plus keynésienne que marxiste – a pu formuler une phrase malheureuse qui continue à faire le tour du monde : « il y a pire que d'être exploité, celui de ne pas l'être du tout ». L'analyse de Marx s'inscrit en contrepoint à cette opposition absolue entre le monde du travail et celui des exclus et des marginaux que traduit le jugement de Robinson. Marx traite l'armée active et l'armée passive comme l'endroit et l'envers indissociables du même processus de prolétarisation.
Néanmoins la majorité des « critiques radicaux » contemporains, en particulier dans ce qu'on appelle l'altermondialisme, restent sur ces positions ambigus. Ces critiques restent alors incapables de comprendre la nature de la financiarisation du système, qu'ils conçoivent comme une « dérive » qu'on peut corriger, le produit du moneytheism. Celui-ci est bel et bien réel – et, soit dit en passant, non moins assassin que d'autres dogmatismes, religieux ou pas. Mais il n'est pas la cause du désastre, il est la conséquence des exigences de la reproduction du capitalisme des monopoles généralisés. Ce système ne peut plus se reproduire qu'en vogant de « bulle financière en bulle financière ». Ces bulles ne constituent pas un obstacle à la croissance qu'elle réduirait, mais, comme John Bellamy Foster l'a démontré , (4) la condition de celle-ci. Ce ne sont donc pas les régulations timides proposées par le G7, ni même celles d'apparence plus radicales avancées par les altermondialistes, qui peuvent répondre au défi.
En s'interdisant de comprendre le système, par crainte d'être attiré par Marx sans doute, on s'interdit de parvenir à le délégitimer véritablement. Le discours critique quitte alors la scène de l'analyse à vocation scientifique pour se déployer sur celle du sermon. Dans la tradition des Etats Unis c'est le « Yes, we can », même s'il eut été plus réaliste de dire « no, we cannot » tant que le capital des monopoles conserve la maîtrise du volant de la machine.
Le véritable objectif de la « science » économique conventionnelle est tout simplement de lui ôter son caractère de science politique, pour la prétendre « neutre, et donc « objective ». Le résultat obtenu est l'annihilation de la capacité critique du citoyen, réduit au statut de spectateur de son histoire. La réponse au défi passe par la renaissance de « l'économie politique », je dirai plutôt du matérialisme historique. A défaut, il est impossible de déligitimer le système.
Une enquête d'opinion que je souhaiterais voir conduite (elle n'existe pas à ma connaissance) montrerait, je crois, que pour la très grande majorité des locataires du territoire des Etats Unis le capitalisme reste parfaitement légitime (et le sermon suffit alors à en corriger les dérives), que cette opinion reste majoritaire, mais d'une manière moins marquée, en Europe (plus faible en France qu'ailleurs), qu'elle est acceptée par la majorité des « classes moyennes » du Sud (particulièrement en Amérique latine) mais qu'elle n'a plus de sens pour les classes populaires du Sud (la grande majorité de l'humanité).
Analyser le marché en le dissociant du mode de production dans le cadre duquel il opère n'a rigoureusement pas de sens ; et les conclusions que cette analyse peut inspirer n'ont aucune pertinence, étant fondées sur l'invention d'un monde imaginaire qu'on substitue à la réalité.
Ce qui existe ce n'est pas « le marché » mais « le marché capitaliste » c'est à dire les marchés des forces de travail qu'elles exploitent.
De surcroît le capitalisme n'est pas même réduisible à ce seul marché capitaliste. Comme Braudel, après Marx, l'a fort bien illustré par des analyses scrupuleuses de la réalité historique, le capitalisme est aussi le produit des fores sociales qui dominent et façonnent le marché, se situent au dessus de lui. Aujourd'hui ces forces sont constituées par celles que j'ai qualifiés de « monopoles généralisés », étape nouvelle du capitalisme des monopoles. Encore une fois : les moyens par lesquels ces monopoles font face aux déséquilibres structurels immanents à cette étape du capitalisme sénile, y compris bien entendu les politiques de « dépolitisation » des peuples et celles conçues pour élargir le champ du pillage impérialiste sont indissociables du fonctionnement apparent des marchés réels.
Mais au delà du capitalisme, quel avenir pour le « marché » ? Sans doute le marché capitaliste, opérant sur la base de la domination de la loi de la valeur, doit-il disparaître avec le capitalisme. Et c'est probablement parce qu'ils restent fixés sur cette forme historique du marché que les marxismes historiques se sont contentés de cette affirmation.
Mais si l'on entend par marché le synonyme de l'organisation de la division du travail et des échanges, il devrait paraître évident qu'aucune société – même simple, a fortiori complexe – ne peut ignorer cette exigence.
On peut donc concevoir un « marché (si on l'appelle ainsi) socialiste », c'est à dire organisant les échanges sur la base de la socialisation de la gestion de l'économie. En préciser davantage les formes d'institutionnalisation relève de ce que Marx qualifiait « d'utopie » qui substitue des formules toute prêtes à l'invention du socialisme par et à travers le déploiement des luttes et des expériences des peuples. Mélange de planification (non bureaucratique) et de négociations politiques entre les partenaires concernés (les travailleurs, les consommateurs, les fournisseurs, les citoyens) certainement. Donnant sa place à des formes nécessaires de « capitalisme d'Etat » fort probablement si l'on pense, avec moi et d'autres, que dans la longue transition au socialisme le recours à ces formes restera longtemps incontournable.
NOTES
1) Samir Amin, Du Capitalisme à la Civilisation ; Syllepse 2008, chap 4.
Samir Amin, From Capitalism to civilisation ; Tulika, Delhi 2010,chap 4
Also Samir Amin, Market Economy or Oligopoly Financial Capital ; Monthly Review, April 2008
2) Samir Amin, La loi de la valeur mondialisée, TdC 2011, chap 4, pp 135 et suivantes.
Samir Amin, The Law of worldwide value, Monthly Review 2010, chap 4, section 6, also, Capitalism and the ecological footprint, Monthly Review, vol 61, N°6, October 2009
3) Samir Amin, Du capitalisme à la civilisation, op cit, chap. 3.
Samir Amin, From Capitalism to Civilisation, Tulika Books2010, chap 3
4) John Bellamy Foster, The Great Financial Crisis, Monthly Review, 2009.
* Samir Amin est directeur du Forum du Tiers Monde
* Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur www.pambazuka.org
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 667 lectures