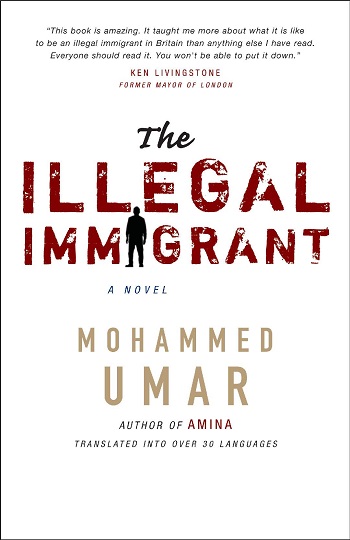Une caravane de la solidarité de Forum social africain a sillonné la Tunisie du 1er au 5 avril, capturé des images, recueillis des témoignages partagé des expériences sur cet élan révolutionnaire qui a impulsé des transformations irriguant aujourd’hui nombre de pays du Maghreb et du Machrek (voir aussi : Quelques aperçus de la révolution tunisienne: la victoire de la dignité sur la peur). Comme le souligne Giuseppe Caruso, «cette révolution peut avoir déjà changé le stéréotype de l’Arabe passivement soumis», mais quant à savoir si elle «influencera la vision de la transition tunisienne, il est trop tôt pour le dire».
Une brève visite ne peut produire autre chose que des esquisses d’un gigantesque travail en cours, qui déplace des gravats d’un endroit à un autre et de la construction de nouvelles relations et institutions résultant de multiples tensions et conflits dont seule une partie apparaît au regard superficiel d’un voyageur de la solidarité. Voyageur souvent peu au fait des spécificités culturelles et sociales locales. De plus, au cours de ces journées où explorions la Tunisie de long en large, du 1er au 5 avril, la vie nous a coulé dessus à un rythme accéléré, trop vite pour que nous puissions nous faire une idée. Avec la distance, les images se cristallisent en une histoire cohérente qui propose un sens, inspire des analyses, suggère des réponses aux questions et des questions aux réponses, dans une tentative de brosser le tableau de la nouvelles Tunisie.
Un défi majeur rencontré par beaucoup de ceux qui se sont efforcés de représenter la révolution tunisienne (et plus généralement les troubles qui déferlent sur la région) provient des stéréotypes banaux et de versions négatives ou positives de l’Orient.
La surprise émerveillée qui a accueilli les évènements en Tunisie, et un peu plus tard en Egypte et les autres pays, trouve son origine dans l’idée fausse que les peuples de la région MENA (Middle East and North Africa) sont incapables d’effectuer un changement réel et de s’émanciper eux-mêmes de l’oppression. Des idées si erronées sont basées sur une connaissance limitée, sur des préjugés, de la propagande politique, du racisme pur.
Ben Ali lui-même (ainsi que Moubarak et d’autres dictateurs de la région) considérait ses concitoyens avec mépris, les estimant trop peu évolués pour qu’on puisse leur confier la démocratie ou un quelconque pouvoir sur leur destinée sociale et économique. La conséquence d’une telle attitude - sa chute - son départ risqué, peuvent être vus comme un avertissement aux élitistes, aux racistes. Cette révolution peut avoir déjà changé le stéréotype de l’Arabe passivement soumis. Pendant que le processus de transition se développe, la jeunesse tunisienne peut contribuer à l’élaboration de nouvelles pratiques démocratiques dont l’impact dépasse les frontières nationales et l’élève au Panthéon des révolutionnaires historiques. Et ces jeunes militants, plus que de n’importe quoi d’autres, sont remplis de fierté pour avoir remis leur pays dans le cours global de l’histoire, non pas comme des esclaves dépendants, mais bien comme des agents qui se sont appropriés le processus de la négociation des valeurs et des institutions d’une planète véritablement cosmopolite.
Comme l’a formulé un militant à Regueb,’’nous sommes heureux d’entretenir des relations avec des partenaires occidentaux’’, mais ‘dans des termes d’égalité et non de charité’ avec des militants, des intellectuels, des ONG plutôt qu’avec des gouvernements. Il envisageait un collaboration horizontale, afin de construire un projet cosmopolite depuis la base défini comme ’marcher ensemble’ plutôt que comme une projection à priori, dépourvue d’histoire de convivialité, de moralité et de nature humaine.
LES EXIGENCES DES REVOLUTIONNAIRES TUNISIENS
‘Nous voulons la justice, l’égalité, la liberté’ (les militantes pour les droits de femmes, Tunis). Il était parfois possible, à Kasserine et Sidi Buzid, par exemple, d’avoir le sentiment que tout était simple et clair. De l’emploi et de la dignité, c’est tout ce que les gens demandaient. Cette exigence est devenue plus complexe lorsqu’elle s’est développée. La justice s’est ajoutée à cette première demande, puis la sanction pour ceux qui ont participé à la répression, aux tueries, à la torture. Et encore, le développement et l’égalité. L’émancipation aussi. Emancipations, en fait, au pluriel. C’est seulement en se libérant eux-mêmes des nombreuses chaînes qui les entravent que les jeunes de Tunisie peuvent atteindre leurs objectifs, leurs emplois, leur dignité, la justice, le développement, la démocratie. C’est pour la liberté que tant d’entre eux ont perdus leur vie.
Libération du dictateur, des systèmes politiques et économiques oppressifs et exploiteurs, des hégémonies idéologiques, des subtiles manipulations politiques, de la classe sociale, du genre, de la race, de l’ethnicité, de la religion, de la sexualité. Il y a d’autres façons pour eux de formuler leurs exigences, d’autres discours, d’autres horizons sémantiques dans lesquelles les aspirations sont exprimées. Il y en a une pour chaque interlocuteur et contexte (comme dans le cas du complexe réseau révolutionnaire d’idées, d’acteurs et de valeurs).
Les militants tunisiens savent que les mêmes objectifs doivent être atteints en relation avec la multiplicité des espaces matériels et de paroles dans lesquels ils vivent. Ainsi, ils exigent immédiatement des droits civils et politiques, l’autorité de la loi, de nouvelles lois électorales transparentes et équitables, une ouverture institutionnelle, le droit de former des partis politiques, de manifester, un gouvernement réactif et des politiques intégrants les droits humains. Ils exigent du développement et de l’égalité, et pour le jeune auquel j’ai parlé sur la place centrale de Kasserine, ‘ un emploi et une vie normale’. C’est l’apparente simplicité de cette demande qui peut être trompeuse. Ce n’est pas une demande simple, qu’‘’ une vie normale’’. Elle est en réalité une demande des plus complexes et les difficultés pour y parvenir ne leur échappent pas. La tension entre la simplicité de la formulation et les obstacles pour y parvenir constituent ce qui motive les grèves de la faim à Kasserine et Sidi Bouzid. Ils savent qu’ils ont le droit à une vie normale et ils l’obtiendront d’une façon ou de l’autre.
LA JEUNESSE OU LES JEUNES DE TUNISIE ?
D’aucuns suggèrent que les jeunes de Kasserine ou de Sidi Bouzid ont moins de sagesse politique que la jeunesse de Tunis. Certains avancent que des décennies de marginalisation, par le reste du pays ainsi que par les privilèges politiques et économiques de la capitale ont généré un profond déséquilibre social et humain. Une des conséquences de ce déséquilibre, est-il allégué par certains de nos interlocuteurs tunisiens, est que la jeunesse dans certaines de ces régions défavorisées sont plus faciles à manipuler et plus sujet à se jeter dans des actions politiques irréalistes et grossières, comme la grève de la faim pour qui veut des emplois immédiatement, pour tous ceux au chômage ; ce qui ne peut aboutir. D’autres ont remarqué que la révolution doit éviter de reproduire parmi les alliés, la marginalisation et l’élitisme de la société en général afin d’éviter de créer des lignes de fracture irréparables entre les militants sous le prétexte de raffinement politique et culturel défini en terme d’exclusion.
Ces réflexions génèrent la question relativement poignante de la catégorie analytique de ‘jeunesse’. Cette catégorie, qui souligne les difficultés existentielles rencontrées par toute une génération pour s’établir comme membre actif et productif de la société, pour la construction d’une famille, pour un jour contribuer à la reproduction de leur société, occulte les nombreuses différences individuelles et sociales.
L’âge ne suffit pas pour comprendre la dynamique en cours en Tunisie. Des déséquilibres régionaux et de classes jouent un rôle crucial, ensemble avec le capital politique et social, la culture, les idéologies, les convictions et la pratique religieuses, le genre et d’autres encore. Cependant que la jeunesse de Kasserine soulignait qu’elle ne voulait pas être impliquée dans des batailles politiques qui se déroulaient en son nom, menée par des gens en qui elle n’avait pas confiance, un membre d’une association estudiantine disait à Tunis qu’ils luttaient pour initier une ‘’ profonde révolution sociale’ qui introduise ‘un monde dépourvu de capitalisme et de classe sociale.’ Il ajoutait : ’’Nous nous sommes révoltés contre un modèle économique parce que nous voulons la Tunisie pour tous les Tunisiens.’’ Ce n’était pas tout. Conscients qu’il y avait nombre de militants occidentaux dans l’audience, il a explicitement envoyé le message à tous ceux qui redoutent la prévalence de la religion dans la nouvelle société tunisienne : ’ En ce qui concerne les idéologies religieuses, nous disons que nous avons vaincu Ben Ali et nous vaincrons toutes les dictatures et tous les totalitarismes.’
Il y a encore un autre problème à considérer avec tous ces clivages et tensions et d’autres différences ressenties par la jeunesse tunisienne. Le contexte de la communication joue un rôle important dans la formulation du code qui gouverne les échanges entre les militants locaux et les voyageurs. Sur les places, nous avons parlé avec certains membres des jeunesses locales. A Tunis, une audience plus large et des rencontres plus formelles, plus embarrassés, ont défini le programme de l’orateur. Bien que cette remarque souligne une évidence, elle a des répercussions importantes sur la façon dont le visiteur est exposé à des nuances et à des détails de l’immense processus de transformation qui implique une société toute entière.
Pour ce qui est de la représentation de la culture politique, j’ajouterais quelques mots dans le post- scriptum de ce texte. A l’instar de la diversité d’exigences et de cadres idéologique, de même les approches politiques et pragmatiques pour des actions en faveur du changement sont nombreuses.
La politique et la pratique du changement
Le débat sur la pratique du changement tourne autour de plusieurs alternatives ou approches articulées, y compris la justice transitionnelle, la lutte ouvrière, les fronts démocratiques révolutionnaires, les pratiques d’insurrection, la désobéissance civile et la représentation politique.
Un membre du syndicat estudiantin à Tunis commentait ainsi la pratique du changement que en tant que syndicat : ‘’ Ils distinguent entre le travail politique et le travail syndical.’ Plus tard il déclara : ‘’Nous voulons un parti politique pour la classe ouvrière’’. Ce serait l’un des 51 partis politiques enregistrés en Tunisie. Une telle floraison de partis politiques témoigne de l’espoir renouvelé des Tunisiens en la politique représentative et la grande différenciation qui a suivi la victoire contre Ben Ali. Une militante du droit des femmes et des activités syndicales commentait que la meilleure façon de poursuivre une lutte démocratique et énergique consiste en ’la création d’un front démocratique afin d’éviter le retour du despotisme et de défendre le respect mutuel et les principes de la démocratie’’.
Dans l’idée de relier la lutte tunisienne avec celle des populations de d’autres régions, une délégation de UGTT va se rendre au Brésil afin d’explorer les moyens de former un parti comme le TP (parti des travailleurs). Et le représentant du CUT de commenter combien il serait utile de partager, avec les militants locaux, l’expérience brésilienne dans le domaine de l’économie solidaire, des coopératives, de l’agriculture familiale, des petites entreprises.
Si la confiance dans les systèmes démocratiques est largement répandue, certains militants soulignent combien le processus doit pouvoir reposer sur des fondements solides afin de réussir. La présence de nombreux éléments ayant fait partie du précédent régime, au niveau du district, de la région et dans les ministères et même dans les organisations sportives nécessite une vigilance constante. Des stratégies plus insurrectionnelles sont préférées par certains de la gauche et parmi les jeunes, et aussi, semble-t-il, parmi les militants religieux.
Les femmes ont eu une grande influence sur le développement, l’articulation et la pratique des méthodologies de changement. Une militante à Tunis a exprimé ainsi sa participation dans le changement et les pratiques de transformation : ’Nous sommes pour une internationalisation des révolutions afin de combattre le capitalisme sauvage.’’ Une autre femme a suggéré la justice transitionnelle et une autre a avancé une combinaison de processus de guérison sur le long terme avec des développements constitutionnelles et une politique représentative.
Le rôle crucial des femmes a été récemment reconnu par le Conseil Suprême pour la Défense de la Révolution qui a adopté, le 11 avril, une loi concernant l’élection d’une assemblée constituante dont l’article 16 établit le principe de la parité des genres dans toutes les listes qui seront présentes à des électeurs. L’importance de ces réalisations ne peut être surestimée. Comme l’ont remarqué toutes les associations de femmes, c’est une occasion unique pour la Tunisie et fournit un exemple à émuler pour toute la région.
Certains, faisant référence aux expérience de justice transitionnelle en Espagne, au Portugal, au Chili et en Europe de l’Est suggèrent que la justice transitionnelle est un chemin plus long, plus complexe et plus raffiné pour en finir avec l’injustice prolongée d’un régime autoritaire qui a usé d’intimidation, de harcèlement, de torture et de corruption afin d’asseoir son pouvoir et de déterminer la distribution des ressources.
Alors que j’écrivais ce texte, j’ai suivi les informations provenant de Tunis où se déroulait une conférence internationale sur la justice transitionnelle et à laquelle participaient quelques-unes des personnes que j’y avais rencontrées. Justice et dignité, démocratie et répondre de ses actes, ces termes dont la résonance est profondément humaine, sont traités comme un long et lent processus, imprévisible et qui implique une multitude d’acteurs dont l’influence dépasse souvent les frontières régionales et nationales. Dans l’élégant centre de conférence où des praticiens, des intellectuels, des militants de la société civile sont accueillis par le ministre de l’Education du gouvernement provisoire, il est fait mention de façon répétée de l’ère nouvelle initiée par la révolution tunisienne et des difficiles tâches à venir. Cependant que le dictateur a fui, la justice doit toujours faire son œuvre, des institutions doivent être développées et la démocratie et l’égalité sont loin d’être une réalité.
DEFIS
‘’ Rien n’a changé, ici Ce sont les mêmes qu’avant, des voleurs, des corrompus’. - Un jeune militant à Kasserine
La multiplicité des demandes, des acteurs et des pratiques est perçue par certains comme une fragmentation stratégique et politique et une potentielle faiblesse accablante. Alors qu’elles ont remporté une victoire rapide et éclatante, les forces révolutionnaires doivent maintenant faire face à un long processus de transition, plein d’épreuves et de défis. Ces défis proviennent de la sphère internationale, du contexte national ou sont en effet internes au front révolutionnaire.
Selon certains militants, les agents internationaux et les institutions du capitalisme et de l’impérialisme essaient de détruire la révolution tunisienne et faire reculer les progrès qu’elle a inspiré dans toute la Tunisie et dans toute la région MENA. De plus, selon un syndicaliste qui s’adressait à l’audience, des informations ont circulé, selon lesquelles des services de renseignement sont entrés dans le pays afin de mettre un terme à la révolution. Les dictatures d’Afrique du Nord ont été largement soutenues par les gouvernements occidentaux qui ont trouvé dans ces hommes forts des alliés fiables et un rempart convainquant contre l’expansion des mouvements islamiques tellement redoutés. Mais la crainte du radicalisme islamique a une dimension interne en Tunisie.
L’influence croissante de l’islamisme et son assurance ne concernent pas seulement les commentateurs occidentaux et les gouvernements. Elles concernent aussi les Tunisiens qui craignent que ces forces, actuellement minoritaires, ne volent la révolution. Comme me le disait un militant des Droits de l’Homme : ’’Je peux comprendre que les Occidentaux continuent de s’interroger sur le risque de l’islamisation. Je vis avec eux et j’ai peur d’eux. Je ne peux qu’imaginer combien ces gens, qui ne savent pas comment les islamistes pensent et agissent, les redoutent.’
Un dirigeant de l’UGTT remarquait, lors d’une réunion à Tunis, que ’la Tunisie n’est pas le Pakistan et qu’il n’y a aucune chance qu’elle devienne comme l’Iran. Nous avons une tradition de vie démocratique et nous savons que les mosquées sont des lieux de culte et non une tribune politique. Nous sommes laïcs et nous croyons en l’autorité de la loi.’
Mais l’islamisme n’est pas le seul défi que doit relever l’Intifada tunisienne. Comme l’ont souligné de nombreux militants, bien que le dictateur ait été chassé, il est nécessaire de transformer la dictature. Les personnes qui représentaient le pouvoir de Ben Ali dans la société, sont toujours dans leur position de gouverneur, de juges, de doyens et de recteur dans les universités et même de dirigeants syndicaux. Ce réseau de pouvoir est non seulement toujours fermement en place, mais aussi étroitement lié et résiste aux changements introduits par l’institutionnalisation de l’effort révolutionnaire. Ils travaillent dans l’ombre, résistent et pourraient lancer une contre-révolution totale.
Il y aussi des défis internes au mouvement révolutionnaire. Il y a une tension entre ceux qui veulent retourner à la normalité et ceux qui veulent combattre pour une victoire totale de la révolution et l’avènement d’une plus large victoire. Leurs adversaires suggèrent plutôt que l’heure est venue de revenir à une politique représentative au travers d’élections libres et justes et des travaux de l’Assemblée constituante. Il semble se développer plusieurs différends entre les militants autrefois unis. Maintenant que l’ennemi principal est vaincu, les différences ont l’espace pour s’épanouir. Les tensions qui se développent sont de nature idéologiques, politiques, identitaires, de classe, etc., et s’opposent les unes aux autres, ce que certains considèrent comme un riche terreau de créativité à cultiver cependant que d’autres voient cette fragmentation comme une menace à la survie même de la révolution dans la mesure où elle s’expose à la puissante contre-révolution.
Visions et paradigmes de transformation
‘’Cet évènement, va, je crois, changer le monde comme la Deuxième Guerre Mondiale et il conduira à toutes sortes de changements qui transformeront le monde’’ (Militante pour les droits des femmes et syndicaliste)
Qu’est-ce que ces dynamiques récurrentes, entre demandes, pratiques politiques, acteurs, ressources et défis suggèrent-elles comme vision et paradigmes émergents de développement vers un monde meilleur, tel qu’il pointe en Tunisie ? Cette question a suscité de nombreuses discussions entre les membres de la caravane et entre nous et les militants tunisiens que nous avons rencontrés ou avec qui nous avons voyagé.
Ces problèmes ont soulevé la question de la solidarité globale, du développement et des modèles politiques et ont préparé le terrain pour la coopération entre militants des quatre coins de la planète. Le secrétaire général de l’UGTT nous a dit à Tunis sa vision et les valeurs de l’UGTT : ’’ La tradition culturelle de l’UGTT est européenne et socialiste à laquelle nous injectons du sang nouveau.’’ Il a encore dit que pour atteindre les objectifs internationaux des travailleurs tunisiens, il est important d’établir des relations plus solides avec le mouvement syndical international et avec les syndicats d’Amérique du Nord, d’Afrique du Sud et ailleurs dans le Sud global.
Tout aussi cohérente est la vision des militants des Droits de l’Homme d’une démocratie globale gouvernée par les droits humains et l’autorité de la loi. Dans l’un et l’autre cas, les militants en réfèrent à une vision de croissance durable. Des valeurs de coopération et d’autonomie sous-tendent les relations entre partenaires internationaux. Les spécificités culturelles et religieuses doivent être intégrées dans les instances locales de développement et des configurations institutionnelles ; le tout devant être tenu ensemble par le tissu économique plus général de la globalisation et de la gouvernance globale. Certains de ces débats résonnent dans un débat global, plus général, et contribuent à son approfondissement et à son élargissement tout en les reliant aux pratiques locales et aux demandes et pratiques des jeunesses révolutionnaires.
Comment cet élargissement et son approfondissement seront influencés par la contribution tunisienne qui, à son tour influencera la vision de la transition tunisienne, il est trop tôt pour le dire ?
En même temps, des militants plus jeunes que les syndicalistes et les militants des Droits de l’Homme expérimentés développent une vision de lendemains meilleurs et apprennent la politique sur le tas après la terreur, la répression, la peur et le désespoir, après avoir été réduit au silence pendant des décennies. Ils soumettent leurs demandes à des institutions gouvernementales auxquelles ils ne font pas confiance. Ils comprennent leurs échecs à générer du développement économique et à faire répondre de leurs actes les politiciens. Ils augmentent, diminuent, modifient leurs demandes et leurs stratégies, ils gagnent, ils perdent et ils retournent mettre l’ouvrage sur le métier. Ils discutent, délibèrent et essaient à nouveau. Compliquées comme le sont ces tâtonnements, complexes les changements d’allégeance et d’alliance, chaotique comme la multiplication des stratégies, des idéologies, des idées, des visions, des désirs, des aspirations, c’est de cela que la démocratie est faite et ce processus promet le plus magnifique des résultats
En écoutant les louanges que beaucoup formulent à l’égard de la politique éducationnelle de Bourguiba, on a le sentiment que le processus d’apprentissage des Tunisiens entre dans une nouvelle phase. Phase qui se déroule à l’extérieur des salles de classe, lieu d’endoctrinement et d’apprentissage pédant de choses, de savoirs inutiles comme l’illustre le taux élevé de chômage parmi les jeunes diplômés. Dans la rue, les jeunes apprennent les relations et la lutte, la négociation, les différences, la médiation. Le savoir, la politique, la culture, la religion, la dignité… Les aspirations se sont finalement rencontrés dans la rue, se sont émancipés des écoles qui ressemblent à des prisons, libérées d’une confiance sans espoir dans quelque chose qui est gracieusement octroyé par un gouvernement et enhardies par le succès ou l’échec, par l’action et la pensée, par les délibérations et la lutte, par le tâtonnement du savoir tel qu’il est, compliqué, sale et parfois sanglant plutôt que le savoir illusoire et stérile imparti par un régime plus ou moins tyrannique.
Dans leur diversité et leur complexité, les révolution dans le MENA peuvent inspirer une nouvelle articulations entre la culture et la religion, la société, l’économie et la politique. Ces articulations sont spécifiques à chaque contexte et ne sont ni nécessaires ni inhérentes. La contribution du printemps arabe à la recette globale est unique, tout comme celle de l’Inde, de l’Indonésie, du Brésil et d’autres démocraties qui comprennent et font l’expérience de la relation entre la religion, l’économie et la politique sont uniques dans le sens où elle ne sont pas dictées par l’équation idéologique : laïcité, économie libérale et démocratie qui est le résultat d’une histoire unique qui n’a pas été, n’est pas et ne sera pas reproduite ailleurs dans le monde.
ENTREZ DANS LE MONDE DU FORUM SOCIAL MONDIAL ?
Une telle compréhension de l’apprentissage collectif et la construction d’une vision partagée, au-delà des frontières nationales, appelle à la solidarité sur la base de la multiplicité des articulations de la démocratie, plutôt qu’un soutien inconditionnel à la reproduction d’un modèle réifié (bien qu’éminemment colonial) de la démocratie qui n’est pas fondé sur une véritable reconnaissance, ne préconise pas l’autonomie et l’autodétermination ( des individus et des communautés) et finit par créer la dépendance et à générer le ressentiment.
La caravane de la solidarité et les rencontres dans le cadre du Forum Social du Maghreb, qui ont eu lieu entre le 19 et le 23 avril, ont contribué à fourbir des arguments pour une forum social régional en Tunisie vers la fin de l’année afin de commémorer le premier anniversaire de la révolution, avec peut-être la perspective d’un Forum Social Mondial en Tunisie ou quelque part dans la région. Notre groupe a témoigné de son intérêt auprès des gens que nous avons rencontrés, à relier leur lutte à notre travail dans le monde et en particulier au travers du travail Forum Social Mondial. Nous aurions dû avoir plus de temps pour discuter avec les militants que nous avons rencontrés pour savoir ce qu’ils pensaient de l’idée du Forum en Tunisie, de l’idée du Forum et des activités transnationales. Ces sujets comme tant d’autres restent en suspens jusqu’à la prochaine visite en Tunisie.
Post Scriptum : tourisme politique et questions éthiques, de la culture de la politique de représentation
Pendant que je faisais état des limitations des représentations dans les médias internationaux de la lutte pour la reconnaissance, la dignité, la liberté, l’emploi, la démocratie et le développement des populations de la région du MENA, les notes ci-après esquissent le « j’y étais » du voyageur politique et son influence sur la représentation des rencontres et des contextes dans un rapport comme celui-ci.
Les buts de la caravane étaient doubles. D’une part elle devait représenter et transmettre la solidarité des militants du Conseil International du Forum Social Mondial, d’autre part, elle devait écouter, voir, enregistrer et rapporter des images et histoires de la révolution et la transition qui étaient en cours en Tunisie. Les objectifs ont été atteints dans la hâte : des accolades et des poignées de main brèves, des histoires rapidement dites. Le non dit, le non communiqué représentaient la majeure partie des échanges. Des allusions, des projections étaient la part la plus profonde des échanges.
L’urgence a voyagé avec la caravane et à chaque étape elle a défini l’espace dans lequel elle s’est installée. Des vidéos ont été tournées, des photos ont été prises avec avidité, des enregistrements anxieux de témoignages, au milieu de la douleur des victimes et des parents, de la famille et des amis qui ont été bien au-delà de ce que nous pensions qu’il était possible d’exprimer ou espérer capter dans nos images vidéos et enregistrements sonores.
L’aspect inévitablement superficiel d’une bonne part de la communication avec des douzaines de personnes que nous avons rencontrées ou dont nous avons entendu parler provient de la limitation, de la réciprocité restreinte. Les deux partenaires devaient expliquer beaucoup de choses et parlaient très vite. Nous devions expliquer qui nous étions, ce qu’est le Forum Social Mondial, ce que nos organisations respectives faisaient et ce qu’elles représentaient et la raison pour laquelle nous étions là. Ils devaient nous dire la révolution, leurs espoirs, leurs frustrations, leurs douleurs, leur angoisse, leur rage, leurs visions, leurs rêves, leurs pratiques. Il y a néanmoins eu des moments de profond engagement, mais ils étaient inévitablement exceptionnels.
Au cours du long périple au travers du pays, les membres de la caravane faisaient état de la relation privilégiée qu’ils ont pu avoir avec l’une ou l’autre personne, par le biais d’un échange rapide, ou juste une accolade ou le contact des mains d’une mère affligée qui essuyait les larmes des yeux de l’un d’entre nous.
A Kasserine et Sidi Bouzid, nous avons écouté une mère pleurer, nous avons écouté un jeune homme mutilé, un garçon passé à tabac, la sœur d’un frère héroïque qui pleurait et ne pouvait plus s’arrêter. Nous avons entendu l’histoire du père d’un adolescent tué et celle du père d’un garçon de 16 ans, un martyr. La voix d’un gars qui avait le pied cassé a résonné longtemps après que nous ayons quitté la salle : ‘Nous avons tout donné, notre sang, notre vie.’’ Nous avons longuement discuté entre nous de nos sentiments, de l’impact de ces histoires et de ces images de corps morts, de ces portraits, de ces sourires inconscients qui ne pouvaient prédire l’avenir.
Un membre de notre groupe, une Italienne, m’a dit : ‘’Au moins, nous les femmes nous savons comment exprimer ce que nous ressentons, nous pleurons. Pauvre de vous !’’ Je me suis fait une note à moi-même dans mon journal. Plus tard, j’ai vu une autre femmes quitter la salle en pleurs et je lui ai demandé ce qu’elle ressentait, comment elle trouvait en elle-même les réponses à ce qu’elle avait vu, qu’est-ce qu’elle se disait à elle-même lorsqu’elle regardait le paysage ondulant par la fenêtre. Elle m’a dit : ’’Je déteste ce que j’ai vu et je déteste la façon dont nous nous sommes comportés, à prendre des photos et tout le reste.’’ Plus tard nous avons fait référence à un jardin zoologique et aux relations récurrentes entre la démonstration anxieuse et le voyeurisme acharné. J’ai eu plusieurs conversations de cette nature dans les jours qui ont suivi et je confirme que nombreux sont ceux d’entre nous qui essaient de faire sens de leurs sentiments et de leurs impressions tout en se demandant et en s’interrogeant les uns les autres sur comment raconter les histoires qu’ils ont entendues et les images qu’ils ont vues sans les marquer de leurs propres sentiments, mais aussi sans omettre une saine dose de réflexion
Il y a des implications troublantes relevant de l’éthique dans de telles rencontres qui sont peut-être trop nombreuses pour trouver toutes leur place ici. Le tourisme politique soulève des questions contradictoires à propos de la relation entre les visiteurs et leurs hôtes et la représentation de ces relations. Il y aussi la question plus large du contexte qui échappe à la relation éphémère auxquels les touristes politiques s’exposent. Cependant que l’authenticité des sentiments concernant les domaines précédemment décrit ne fait pas de doute, la connaissance des conflits en jeu peut être soit limitée soit excessivement simplifiée dans des codes symboliques qui ne sont pas plus que des projections de la part de l’observateur étranger, ensuite reproduit dans un espace un monologue d’images qui sont choisies sur la base d’intérêts spécifiques et de sensibilités qui sont entièrement dans le regard de l’observateur, tout en prétendant qu’il s’agit d’un dialogue. Des communications intenses, comme certains d’entres nous ont décrit celles qu’ils ont établies avec les militants tunisiens ne sont peut-être pas un remplacement d’une relation longue et engagée qui peut s’impliquer et transformer le code symbolique simplifié et ces projections qui trop souvent colorent les courtes rencontres avec des militants rencontrés lors de la caravane de solidarité en Tunisie A quoi s’ajoute une considérations souvent répétées par nombre d’entre nous : on ne sait pas grand-chose de la Tunisie, de l’Islam, de la dynamique sociale et culturelle de la région que nous visitons, combien limitée était notre connaissance de l’histoire précoloniale, coloniale, l’indépendance et la post-indépendance de la Tunisie.
Les circonstances dans lesquels les témoignages ont été recueillis - une grande salle de conférence (deux d’entre elles avaient des estrades et dans un cas le panel était sur l’estrade) ou au quartier général de UGTT, ont généré encore plus d’ambiguïté et de malentendus potentiels (dont la dimension nous est inconnue puisque nous n’avons pas eu l’occasion d’échanger nos perceptions respectives de l’autre). En effet, partout où nous sommes allés, des victimes, des membres des familles et des amis se sont rassemblés afin de pourvoir le visiteur en récit de la révolution et de telles prestations impliquent de multiples projections, pas seulement celles des visiteurs à propos des hôtes mais aussi celles des hôtes sur les visiteurs, se demandant qui ils sont et ce qu’ils attendent.
J’ai demandé à une femme de notre groupe : ‘’ Pourquoi faisons-nous cela si on défie ainsi notre compréhension fondamentale, notre éthique des relations humaines mutuellement transformantes et le militantisme ?’’ Elle a répondu : ‘’ Eux, (ces militants, victimes et parents, leurs prestations au quartier général de l’UGTT à Kasserine) correspondent à nos propres projections et désirs de changer le monde.’’ Plus tard elle a ajouté :’’Il y beaucoup de projection et peu d’écoute’’ dans la façon dont nous avons interagi avec nos hôtes. Donc dans ce sens, la représentation de ce que nous avons vu et entendu (comme celui-ci) peut être sélectif des aspects qui illustrent nos idées de ce qui est nécessaire pour changer le monde. Il se peut même que nous ayons contribué à renforcer la codification du discours, de sa sclérose dans des prestations qui piègent les acteurs, loin de la transformation.
La manifestation de douleur et de pertes qui nous ont fait pleurer, les revendications et les exigences que nous avons applaudies, les descriptions de causes et d’effets auxquelles nous avons souscrit et les visions que nous avions et auxquelles les réactions ont été moins émancipatrices, c’est évidement possible que ce soit là une projection de plus dans laquelle l’asymétrie de pouvoir entre eux et nous est peut-être le mieux illustrée par le fait que, après chaque rencontre, eux retournait à leur vie de chômeur ou de famille éprouvée et nous, nous retournions vers nos hôtels confortables et nos verres au bord de la piscine.
La vitesse à laquelle nous avons rencontré des gens, vu le contexte, écouté leurs histoires et avons poursuivi notre chemin vers la prochaine étape implique des attitudes et des croyances qui sont en contradiction avec les valeurs déclarées et implicites de notre caravane. La vitesse et la connectivité peuvent en effet être clairement considérées comme étant l’apanage de l’idéologie du néolibéralisme social. Rapidité et connectivité ont été les prémisses sur lesquels notre caravane s’est construite, termes selon lesquels il est possible de rapporter et de représenter la lutte sociale au travers de portraits et d’entretiens, donnant ainsi à la lutte une visibilité mondiale grâce à une circulation rapide sur Internet.
Il y a un risque additionnel qui dérive de la fugacité des relations établies pendant les quelques jours de notre permanence en Tunisie et de l’ignorance relative des spécificités sociales, culturelles et historiques de la région que nous avons visitée L’un d’entre eux est de légitimer un discours politique que nous ne comprenons pas entièrement, sur lequel nous ne sommes pas d’accord, que nous renforcions des projections et les représentations que les gens se font de nous et que nous n’avons pas les moyens de négocier. Ce n’était pas toujours facile de comprendre les politiques subtiles qui avaient cours entre nos mentors et les gens que nous visitions. Cela n’a pas toujours été possible de comprendre comment nous étions présentés et comment nous étions décrits. Il n’a jamais été possible de savoir comment nous étions perçus et comment notre relation avec notre hôte direct et notre guide était perçue.
Une autre mise en garde et reconnaissance de la complexité impliquée dans la représentation de la lutte révolutionnaire et la transition dans laquelle les Tunisiens se trouvent actuellement concerne la relation que nous avons construite entre nous, membres de la caravane, aussi bien les Tunisiens que les visiteurs dont peu se connaissaient au préalable, et comment les longues discussions ont aidé à cristalliser les perceptions et les pensées en une forme de représentation collective de ce que nous avons vu au cours de ces journées.
Pour finir, les relations personnelles, professionnelles de militants entre les membres de la caravane se sont fondues les unes dans les autres au défi des frontières entre les différentes dimensions. C’était certainement un des aspects les plus gratifiants de la solidarité de la caravane qui nous a permis de parler des heures durant au cours des long parcours en bus. En fait nous avons passé plus de temps entre membres de la caravane qu’avec les militants que nous avons rencontrés. Nous avons comparé nos impressions, nous avons raconté des histoires, nous avons partagé des émotions, des images, des aspirations et des visions individuelles et collectives de transformations globales. Nous avons parlé de nous-mêmes comme il est possible seulement dans les moments de partage d’une expérience émotionnelle, comme seulement une longue route peut l’inspirer.
Mais nous avons aussi écrit, pris des photos des paysages époustouflants qui défilaient devant nos vitres. On a aussi beaucoup chanté, dans le bus et dans un hôtel à Gafsa. La prestation de Rita et Fairouz de Marcel Khalife, de Bektob Ismak, et beaucoup d’autres sont simplement inoubliables
* Giuseppe Caruso est membre du Conseil international du Forum social mondial – Texte traduit de l’anglais par Elisabeth Nyffenegger
* Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne à Pambazuka News
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 448 lectures