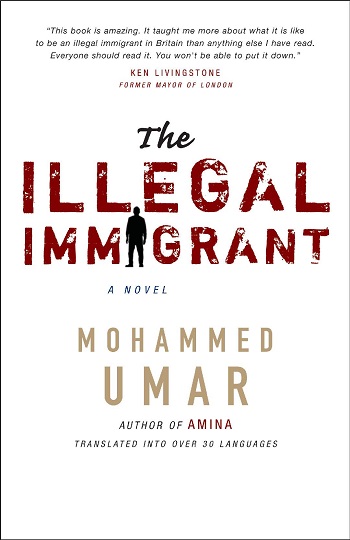Ces dernières années, les mass médias ont régulièrement été au centre de l’intérêt public au Sénégal. Ce n’est bien sûr pas un hasard, puisque si l’on regarde sur la longue durée, on peut dire que la presse est soumise à un changement dynamique depuis le début des années 1970, et cela s’est encore intensifié au début des années 1990. Aujourd’hui, la fin de cette mutation n’est toujours pas d’actualité. Au cours des processus de libéralisation, de pluralisation et de popularisation, le marché des médias s’est différencié. Il s’est aussi partiellement institutionnalisé. Quant à l’usage des médias, il a également augmenté. Néanmoins, il nous semble opportun de ne pas nous arrêter à la description de ces aspects mais de nous demander, quelles sont les raisons profondes de l’évolution des médias ? Où ils en sont aujourd’hui ? Quelles sont les défis les plus sérieux auxquels ils font face?
De façon simplifiée, on peut dire que la sphère publique sénégalaise est constituée d’acteurs politiques, économiques, religieux, médiatiques et d’acteurs de régulation. Cette sphère est peu transparente, car les rôles de ces différents acteurs ne sont pas complètement séparés. Il est vrai qu’une partie considérable du processus de démocratisation et du développement d’une conscience citoyenne est le fait de la presse, mais, paradoxalement, les transformations qu’elle a subi ces dernières années ont contribué, en contrepartie, à un noyautage des fondations démocratiques. Cela s’observe en particuliers dans la non-séparation des pouvoirs entre sphère exécutive et judiciaire, de même qu’entre sphère politique et religieuse.
La séparation de ces sphères est ancrée dans la Constitution, mais elle est loin d’être fonctionnelle dans la réalité. Les acteurs religieux pénètrent de plus en plus directement dans les sphères politique et médiatique. Les conséquences sautent aux yeux dans le secteur de la presse où journalistes, politiciens, commerçants et marabouts collaborent certes, mais se battent le plus souvent pour l’influence, le contrôle et la propriété. Tous les groupes d’acteurs disposent d’organes de presse et essaient d’exercer une influence sur les contenus rédactionnels des médias qui ne leur appartiennent pas. Tandis que les acteurs politiques s’intéressent principalement à une couverture positive et peu critique des faits d’actualité qui les concernent, les acteurs religieux, eux, essaient de favoriser le conformisme journalistique. Si les rédactions osent les contrarier, elles prennent alors le risque de représailles qui peuvent prendre des contours violents.
C’est la raison pour laquelle la liberté de presse est en danger au Sénégal, lorsque les journalistes enquêtent et révèlent les agissements illicites des politiques ou de personnalités en vue dans la bonne société. Afin d’endiguer un journalisme d’investigation et critique, le gouvernement - et la justice qui lui est soumise - utilisent une législation incohérente et arrêtent de façon arbitraire des journalistes. Ces pratiques visent une autorégulation prononcée et à terme, une autocensure des journalistes.
L’expérience a montré que ce genre de conflits trouve souvent une résolution qui suit un modèle typique : la société civile proteste et essaie d’intervenir de manière informelle auprès des représentants du gouvernement, puis les journalistes arrêtés sont finalement libérés. Au-delà, quand on parle de violations répétées de la liberté de presse, il faut aussi comprendre violence morale qui se manifeste par des menaces psychologiques et pas seulement agressions physiques.
Compte tenu la concurrence économique des entreprises médiatiques et la stratégie de popularisation des journaux, ce contexte conflictuel a contribué à une crise d’identité des journalistes sénégalais. En fait, les journalistes ne savent pas comment se comporter dans ce contexte avec ses exigences contradictoires. Le manque d’orientation ne se reflète pas seulement dans des conceptions de rôle variables, mais aussi dans les contenus des journaux. A l’exception des journaux professionnels comme Le Quotidien, Sud Quotidien et Wal Fadjri, des critères de qualité de base sont violés. Ceci est démontré par l’orientation idéologique ainsi que par la violation des règles de l’objectivité, de la crédibilité de l’information, de la pondération de l’agenda thématique et du respect de la sphère privée.
Les raisons de la crise identitaire sont à chercher dans le contexte sociopolitique et les pratiques culturelles. Prenons par exemple les acteurs politiques et religieux : ils aspirent, généralement, à une visibilité publique et à l’accès aux différentes ressources. De cette façon, ils limitent la marge de manoeuvre des journalistes et de la société civile. Cependant, les journalistes, eux aussi, s’aventurent dans des sphères et jouent des rôles qui ne sont pas les leurs.
Un caractère essentiel du contenu de la presse d’information générale consiste dans le mélange des différents genres journalistiques, notamment le compte rendu, l’analyse et le commentaire. Ce mélange ne donne aucune indication de décodage aux lecteurs. Au-delà, la presse populaire viole de façon continue les règles de l’éthique et de la déontologie. Mais elle est aussi un moteur du changement social, car elle permet de briser des tabous. Des thèmes comme la délinquance, la violence, la criminalité, le sexe, le voyeurisme ou la dénonciation des personnes privées et publiques devraient assurer l’attention du public. En cela, la presse devient un parasite social.
Même si certains titres de la presse populaire arrivent, grâce à des gros titres provocateurs, à atteindre un tirage élevé, ce sont avant tout des journalistes jeunes, mal formés qui les animent. D’un côté, il y a un pluralisme effréné de la presse, mais de l’autre on assiste à un nivellement par le bas de la qualité des journalistes. La précarité est donc un caractère important des mass médias sénégalais. Elle est responsable d’une fluctuation significative des journalistes et des titres. La précarité est le résultat aussi des revenus marginaux engendrés par la publicité et le manque de propension des Sénégalais à dépenser de l’argent pour acheter un journal. Le journalisme reste une affaire déficitaire que les subventions publiques ne peuvent compenser. Une des conséquences les plus graves de cette situation précaire, c’est qu’un nombre considérable de journalistes sont « corrompus », acceptant de l’argent ou des cadeaux des politiques ou des personnalités qui veulent s’assurer une couverture agréable.
Afin de survivre économiquement, bon nombre de rédactions collaborent avec des commerçants informels qui ne s’occupent pas seulement de la distribution des journaux, mais qui se chargent également des coûts d’impression, de papier et même des salaires. D’un côté, cette stratégie assure la survie à court terme du titre, mais de l’autre côté, les journalistes se livrent aux commerçants informels qui abusent de leur pouvoir économiquement.
La conflictualité des médias fait référence au manque de régulation dans le secteur, et à un déficit d’Etat de droit, résultat d’un Etat faible. Les acteurs politiques au Sénégal n’ont jamais réussi à atteindre une légitimité entière et une autorité intégrale. Ce manque de régulation nous réfère aussi aux déficits démocratiques. Les violations répétées de la liberté de presse et le dysfonctionnement de la séparation des pouvoirs entre l’exécutif et la judiciaire ainsi qu’entre la sphère politique et religieuse font du Sénégal un état semi-autoritaire.
Malgré tout, ce ne serait pas apprécier les mass médias sénégalais à leur juste valeur que de ne pas reconnaître que les acteurs compensent ces déficits par des accords interpersonnels au sein des réseaux organisés de façon clientéliste. Ces accords s’inscrivent dans la culture sénégalaise de la «teranga» (hospitalité, bonnes manières), établie depuis des siècles. Elle règle les relations des membres de la société et garantit la fonctionnalité de ces relations. De cette façon, l’insécurité est réduite et la base pour l’informalité est créée.
L’informalité s’est montré le modèle de pratiquement tous les acteurs, y compris les journalistiques. Ils représentent des rôles différents pour s’adapter à des situations différentes. Selon le contexte, ils choisissent le rôle du reporter, du chien de garde, de l’avocat ou du griot qui se montre sensible à la réception illicite de l’argent ou des cadeaux. A cause de l’ambivalence des différents rôles et du manque de professionnalisme, la presse sénégalaise ne dispose que d’une faible crédibilité dans la population.
Vu l’illettrisme très répandu, c’est un exploit que de voir le nombre de Sénégalais qui s’informent à travers la presse. Cela dit, leur accès est majoritairement de nature informelle : au lieu d’acheter des journaux, ils se réfèrent surtout à des modèles privés et para-commerciaux. Mais la «teranga» concerne aussi le contenu des journaux : au Sénégal, il n’est pas habituel d’adresser des critiques directes, ce qui contribue à reléguer l’investigation journalistique en marge.
Au-delà de ça, le mélange des différents genres journalistiques et le journalisme d’opinion, très présent dans la presse sénégalaise, se laisse expliquer d’une manière assez simple : la tradition orale et la culture du charme et de la séduction à la sénégalaise ont largement imprégné la presse. Le lecteur veut être courtisé d’un point de vue stylistique, et séduit grâce aux thèmes. Voilà pourquoi le journaliste ne peut pas se contenter de donner des informations sèches. Il se doit de laisser transparaître son opinion et d’écrire avec verve. Les Sénégalais aiment les belles plumes. Aujourd’hui, la tradition orale ne signifie pas l’absence des pratiques de lecture mais l’intégration des éléments stylistique oraux dans la communication écrite.
Le pluralisme et la popularisation des mass médias ont cependant contribué à une croissance de leur utilisation par le populations. Même si les différences entre les groupes socio démographiques et les endroits géographiques restent significatifs, l’usage médiatique est un élément intégral des pratiques sociales au Sénégal aujourd’hui. La radio, diffusée en majorité dans les langues nationales, est écoutée par 95.5% des interviewés, dans une étude que nous avons réalisée. Elle est désormais perçue comme le média le plus informatif, le plus divertissant mais aussi le plus crédible. Pratiquement tous les interviewés l’utilisent quotidiennement.
La télévision, qui est souvent regardée en groupe, jouit également d’une grande popularité. Tandis que son usage en milieu urbain atteint presque l’usage radiophonique, il décline en milieu rural. La presse écrite, quant à elle, est lue par 28.6% des Sénégalais interrogés, mais elle trouve un plus grand public au sein des auditeurs de la revue de presse. De même, l’étude montre que la presse écrite a quitté les cercles hermétiques de l’élite traditionnelle. Aujourd’hui, ce ne sont plus uniquement les universitaires, les politiciens et les entrepreneurs qui lisent, mais également certains apprentis, employés des secteurs formels et informels ainsi que les femmes de ménage, les retraités et les chômeurs. Au-delà, il arrive que des illettrés regardent des photos des journaux ou se laissent lire le contenu.
Si quelques journaux en langues nationales sont publiés, leur signification sociale et économique est plutôt marginale.
La lecture des journaux reste tout d’abord un phénomène dakarois, car plus on s’éloigne de la capitale, plus la fréquence diminue. Les quotidiens tirent généralement entre 3 000 et 20 000 exemplaires. Mais les journalistes sont confrontés à des fluctuations énormes : 79.9% des interviewés ne lisent les journaux qu’en cas de scoop ou d’événements importants. La décision d’acheter un journal est généralement faite spontanément au kiosque et lorsqu’on rencontre des vendeurs ambulants. Il faut voir là le fait que les clients peuvent comparer les titres des différents journaux. En d’autres termes, les journaux n’ont pas encore réussi à atteindre une grande fidélisation de la clientèle.
Le lecteur prototypique est aussi bien masculin que féminin et a moins de 45 ans. Il travaille comme employé ou est en formation. Deux tiers sont d’origine sénégalaise et un tiers étranger. Il s’intéresse à la politique et veut s’informer ou se laisser conforter dans son opinion personnelle. Le lecteur prototypique préfère les rubriques politique, sport, médias et société, mais souvent il ne lit que les articles qui sont présentés avec un titre attirant. La lecture est relativement courte et peu intense. Quelque 53,5% des interviewés lisent moins de dix minutes et se limitent aux titres et à parcourir certains articles. Généralement, la lecture se fait de façon régulière à occasionnelle et de préférence le matin ou au cours de la matinée.
Vue la pauvreté chronique qui caractérise la majorité de la population sénégalaise, les lecteurs préfèrent généralement emprunter plutôt qu’acheter des journaux. Une copie achetée est souvent lue par dix personnes, voire plus. Ce comportement exerce une influence sur le lieu de la lecture, puisqu’il se fait généralement là ou les lecteurs ont accès à leur journal. Il s’agit souvent du lieu de travail, d’un télécentre ou de lieux publics. Si la lecture se fait dans l’espace public, l’interruption de la lecture à cause des interactions sociales est fort probable. Quant aux personnes qui achètent des journaux, ils préfèrent les lire à la maison, au bureau ou dans les transports publics. Après la lecture, ils gardent le journal, le prêtent à d’autres personnes ou l’utilisent à d’autres fins.
* Frank Wittmann est directeur de l’Unité des affaires internationales de l’Université des Sciences Appliquées à Zurich en Suisse.
* Veuillez envoyer vos commentaires à ou commentez en ligne sur www.pambazuka.org
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 239 lectures