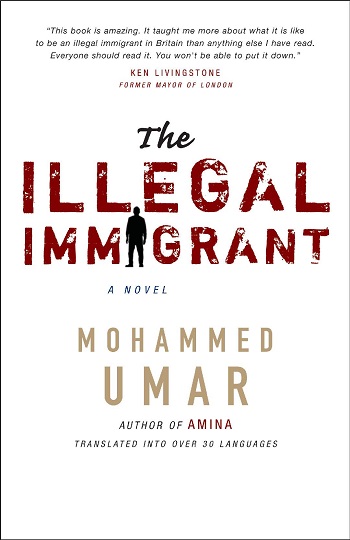Passant en revue l’évolution de la presse africaine depuis la colonisation, Guy Marius Sagna et Fodé Roland Diagne fixent les enjeux actuels pour l’Afrique et la nécessité de disposer de médias qui porte «les ouvriers, les paysans, les travailleurs de l’informel, les femmes, les jeunes et l’intelligentsia progressiste africaines à prendre leur destinée en mains et à rompre les liens d’asservissement imposés par la Françafric, l’Eurafric et l’Usafric aux peuples d’Afrique». Pour eux, «c’est dans ce cadre qu’il faut classer la nécessité d’une presse alternative anti-libérale comme Pambazuka».
La seconde phase de décolonisation africaine a besoin d’une presse alternative populaire !
Dans le sillage de la défaite et la restauration du capitalisme en URSS dans les années 1989-91, pèse sur les forces sociales exploitées (ouvriers et paysans) et les peuples opprimés la tyrannie de la pensée, de l’information unique libérale au service du joug asservissant de la triade impérialiste (USA, UE, Japon). Nous sommes entrés dans l’ère de l’info et de la pensée Coca Cola et Mac Do.
En Afrique la Françafric, l’Eurafric et l’Usafric ont pollué les ondes et les esprits par un monopole aliénant de l’information à travers leurs chaînes TV, leurs radios et leurs journaux. Même la presse locale dépend fortement des sources d’information contrôlées par les magnats de la presse mondiale, répercutant les intox et manipulations fabriquées par les services secrets occidentaux et l’idéologie totalitaire néo-libérale produites par les « thinks thanks » des grands groupes à dimension planétaire que sont les Transnationales.
DE LA PRESSE MILITANTE SOUS LA COLONISATION…
La première phase des luttes anti-coloniales a été marquée par l’émergence et le développement d’une presse militante au service de l’objectif de l’indépendance. Du « Cri Nègre » à « La Race Noire des communistes » de Lamine Arfan Senghor et Tiémokho Garang Kouyaté, dans les années 1920 et 30, à la création de Présence Africaine, en passant par le mouvement de la négritude des étudiants antillais et africains, les écrits, analyses et publications sont une critique engagée de l’idéologie raciste et coloniale qui vont culminer après la seconde guerre mondiale antifasciste, avec la création d’organisations indépendantistes comme le Rassemblement Démocratiques Africains (RDA), l’Union des Populations du Cameroun (UPC) et le Parti africain de l’Indépendance (PAI), pour citer quelques unes des plus progressistes.
Ces organisations seront toutes dotées de journaux centraux et locaux en plus des tracts qui vont jouer un rôle de « propagandistes, d’agitateurs et d’organisateurs collectifs » clandestins, semi-légaux ou légaux selon le moment jusqu’à la proclamation des indépendances.
Précisons que malgré des efforts et un travail fait d’héroïsme et de courage, cette première phase se soldera par la défaite du courant national-révolutionnaire indépendantiste, suite aux massacres coloniaux et crimes génocidaires comme à Thiaroye en 1944, à Sétif en 1945, au Madagascar en 1947, au Cameroun en 1955, en plus des assassinats des leaders comme Um Nyobe, Moumié, Afana, Ouandié, Lumumba et la corruption-trahison d’autres comme, celle de Houphouët en 1950. Il y a aussi le piège balkanisateur de la loi cadre de 1956, le blocus de la Guinée du Non de 1958, avec la complicité de Senghor et Houphouët, voire l'explosion de la fédération du Mali et les accords de coopération militaire, économique et monétaire qui installe la Françafric à partir de 1960.
…A LA PRESSE D’OPPOSITION MILITANTE POST INDEPENDANTISTE…
Une fois les indépendances proclamées et mise en place le système néo-colonial, on assista à près de deux décennies de confrontation entre la presse officielle des gouvernants et une presse militante clandestine, surtout de la gauche marxiste-léniniste.
Mis à part le PAI (et ses presses territoriales), qui sera réprimé par les pouvoirs semi-coloniaux, notamment celui de Dia-Senghor au Sénégal, c’est essentiellement dans les universités et lycées des pays africains et au sein de la Fédération des Etudiants d’Afrique Noire en France (FEANF), que surgiront, en lien avec les débats du Mouvement Communiste International (MCI), les presses clandestines ronéotypées doublées de tracts et de graffitis ou dazibao, pour reprendre l’appellation de l’obédience maoïste.
Au milieu des années 1970 et au tournant des années 1980 ont eu cours des expériences de journaux clandestins dans des dictatures, semi-légaux ou légaux dans des démocraties de multipartisme limité. Ces journaux étaient édités et diffusés par des organisations marxistes-léninistes clandestines qui subirent une répression dure.
… A LA PRESSE ENTREPRISE …
A partir des années 1979-80, le FMI et la Banque Mondiale débarquent en Afrique avec les Plans d’ajustement structurel (PAS) pour récupérer la dette. Les Etats mis sous perfusion au nom du « moins d’Etat » sont « dégraissés » et l’offensive libérale prône « l’esprit d’entreprise ». Beaucoup d’anciens militants de gauche, brillants universitaires, se reconvertissent en « opérateurs économiques », en « chefs d’entreprises ». Pour d’autres l’engagement militant d’antan mute en engagement humanitaire dans les ONGS qui essaiment dès lors en Afrique, avec à la clef l’explosion des « micro-crédits », des mini-entreprises dans les secteurs agricoles ou coopérative de services de « lutte contre la pauvreté », etc.
Parallèlement naissent et se développent les journaux privés qui, au nom d’un prétendu « journalisme objectif dépolitisé », ont en réalité, pour la majorité, été des relais de l’OPA médiatique de l’Occident impérialiste sur l’information en Afrique. C'est la période de triomphe tous azimuts du libéralisme. Des indices probants peuvent être avancés : comment, par exemple, Cuba et sa résistance héroïque sont maltraitées dans la presse dite « libre » africaine. Comment sont ignorés dans la presse africaine dite « indépendante » les figures combattantes comme les vrais héros et martyrs assassinés ou vaincus de la liberté que sont les Nasser, Nkrumah, Mulélé, Cabral, Sékou Touré, Sankara, etc.
Bien entendu, ce qui est dit ici n’enlève en rien la nécessité d’une étude approfondie pour distinguer quelle presse a résisté au tsunami idéologique, politique, culturelle et analytique de la victoire temporaire de la contre-révolution bourgeoise contre l’ex-camp socialiste.
Toutefois l’avènement de la presse privée ou des médias d’entreprises est aussi à mettre en rapport avec la montée des exigences démocratiques et des soulèvements populaires qui vont déboucher sur les « conférences nationales », accompagnées par l’impérialisme Françafricain sous la houlette du social-démocrate Mitterrand. C’est notamment au Mali que le peuple payera un prix fort pour renverser l’autocratie Moussaïste (Ndlr : de l’ancien président du Mali, Moussa Traoré) dans le processus d’une révolution inachevée.
Ainsi le combat de la presse militante contre les autocraties africaines a préparé les conquêtes démocratiques qui donneront ensuite la presse dite libre. Il s’agit, objectivement, d’une avancée démocratique, mais récupérée par les forces de l’argent hier tapies derrière les dictatures et aujourd’hui faisant fonctionner la démocratie libérale des riches. Laquelle va ensuite engendrer les successions monarchistes des "fils" aux "père" comme au Gabon, au Togo, comme a voulu le faire l'Egypte et comme veut le faire le Sénégal. Concédons ici que la presse a néanmoins, parfois, une fonction de dénonciation de la terrible gangrène de la corruption, de la gabegie, du népotisme qui font que le pouvoir d‘Etat en Afrique est le lieu par excellence d’une « accumulation primitive du capital » en milliards, que les peuples payent par la malnutrition, l’analphabétisme, les maladies, la pauvreté extrême et autre fléaux du non développement.
… A LA NOUVELLE PRESSE POUR UNE ALTERNATIVE ANTI-LIBERALE ET ANTI-IMPERIALISTE…
Les révolutions en cours en Tunisie et en Egypte ont ramené à la surface les processus souterrains alternatifs qui travaillent les entrailles des sociétés africaines soumises à des décennies de diktat des plans d’ajustement structurel (PAS) libéraux, du FMI et de la Banque mondial. Les forces sociales, les impérialistes et les bourgeoisies locales, qui ont profité en milliards de la tyrannie du libéralisme au détriment du développement de l’Afrique, n’ont plus rien à offrir comme illusion. En ce début de la seconde décennie du XXIéme siècle, les peuples d’Afrique relèvent la tête tout comme les peuples d’Amérique du Sud ont relevé la tête dès la fin de la première décennie de ce XXIéme siècle. Auparavant l’Asie a pris les devants en raison des succès révolutionnaires et progressistes consolidés des luttes de libération, dès la première phase de décolonisation entre 1945 et 1960. C'est le cas en Chine, de l'Inde, de la Corée (nord et sud), du Vietnam, etc.
Aujourd’hui il s’agit de se débarrasser des régimes autocratiques qui perdurent en Afrique, mais surtout de poser frontalement la question des voies du développement, donc de l’alternative au libéralisme prédateur des impérialistes et de leurs affidés africains. Il s’agit d’élaborer les antidotes théoriques à la pensée libérale qui a échoué en pratique aux yeux de millions d’Africains victimes de l’oppression impérialiste. Il s’agit, concrètement, d’amener les ouvriers, les paysans, les travailleurs de l’informel, les femmes, les jeunes et l’intelligentsia progressiste africaines à prendre leur destinée en mains et à rompre les liens d’asservissement imposés par la Françafric, l’Eurafric et l’Usafric aux peuples d’Afrique. C’est dans ce cadre qu’il faut classer la nécessité d’une presse alternative anti-libérale comme Pambazuka.
… ET A SON COMPLEMENT INDISPENSABLE UNE PRESSE DANS NOS LANGUES NATIONALES AU SERVICE DE L'EMANCIPATION DU PEUPLE
« Si nous sentons en nègres, nous nous exprimons en français, parce que le français est une langue à vocation universelle (…). Je sais ses ressources pour l’avoir goûté, mâché, enseigné, et qu’il est la langue des dieux. (…) Chez nous, les mots sont naturellement nimbés d’un halo de sève et de sang ; les mots du français rayonnent de mille feux comme des diamants. Des fusées qui éclairent notre nuit » (L. S. Senghor cité par Ngugi wa Thiong’o dans « Décoloniser l’espriét, éditions La fabrique, 2011).
Terrible aliénation du colonisé, à quoi David Diop répliquait : « Dans une Afrique libérée de la contrainte, il ne viendra à l’esprit d’aucun écrivain d’exprimer autrement que par sa langue retrouvée ses sentiments et ceux de son peuple. Et dans ce sens, la poésie africaine d’expression française, coupée de ses racines populaires, est historiquement condamnée » (idem). Plus radicalement, David Diop ajoutait : « Le créateur africain, privé de l’usage de sa langue et coupé de son peuple, risque de n’être plus que le représentant d’un courant littéraire parmi d’autres (et pas forcément le moins gratuit) de la nation conquérante. Ses œuvres, devenues par l’inspiration et le style la parfaite illustration de la politique assimilationniste, provoqueront sans nul doute les applaudissements chaleureux d’une certaine critique. En fait, ces louanges iront surtout à la colonisation qui, lorsqu’elle ne parvient plus à maintenir ses sujets en esclavage, en fait des intellectuels dociles aux modes littéraires occidentales. Ce qui, d’ailleurs, est une autre forme, plus subtile, d’abâtardissement » (idem).
Dans ce débat, Ngugi wa Thiong’o se positionne ainsi à Dakar, en 1969, dans un colloque de l’Unesco : « Notre culture ne renaîtra pas tant que les langues africaines ne seront pas enseignées dans nos pays. Nous connaissons désormais les effets des systèmes coloniaux : en imposant leur langue, ils dévalorisent celles des habitants et font de l’apprentissage de l’idiome colonial un moyen de distinction ; quiconque en acquiert la maîtrise se met à mépriser les paysans et leurs langues barbares. Toute langue est porteuse de valeurs forgées par un peuple au cours d’une période donnée ; et il serait peu raisonnable, dans un pays où 90% de la population parle les langues africaines, de ne pas les enseigner dans les écoles et les facultés » (idem).
L'écrivain engagé, qui écrit dans sa langue maternelle, de faire le constat pertinent suivant : « la grande tradition humaniste et démocratique d’abord, Eschyle, Sophocle, Shakespeare, Balzac, Dickens, Dostoïevski, Tolstoï, Gorki, Brecht et d’autres, autrement dit une littérature universelle mais reflétant avant tout l’expérience européenne de l’histoire – présentée le plus souvent comme si tous ces auteurs, auxquels on doit les plus aiguës et les plus pénétrantes observations sur la civilisation bourgeoise, n’avaient jamais été préoccupés que par les thèmes éternels de l’amour, de la peur, de la naissance et de la mort. On nous présentait leur génie comme un cadeau supplémentaire de l’Angleterre au monde, après la Bible : William Shakespeare et Jésus Christ étaient venus apporter la lumière à la ténébreuse Afrique »(Idem).
Et enfin d'en conclure que « le même schéma se retrouve aujourd’hui dans le portrait que brossent les médias occidentaux des différents chefs d’Etats africains. Ceux qui (…) ont plus ou moins hypothéqué l’avenir de leur pays au profit de l’impérialisme euro-américain, sont régulièrement loués pour leur réalisme, leur fiabilité, leur respect de la démocratie et la croissance inégalée qu’affiche l’économie de leur pays ; ceux qui, au contraire, comme Nkrumah au Ghana ou Nasser en Egypte, œuvrent pour permettre à leur pays d’accéder à un semblant d’autonomie, sont réprimandés pour le simplisme et l’irréalisme de leurs vues, leur caractère doctrinaire et le chaos économique dans lequel baigne leur pays.
La littérature avait donc inventé, longtemps avant l’apparition de la télévision et des médias populaires, les bases du vocabulaire et de la symbolique raciste. Les enfants africains qui découvraient la littérature dans les écoles coloniales expérimentaient le monde à travers des livres inspirés par une vision entièrement eurocentrée. Les images qu'ils rencontraient dans les romans étaient en accord avec leurs leçons d'histoire et de géographie, de sciences et de technologie : l'Europe était le centre de l'univers » (idem).
Aujourd'hui, par-ci par-là et généralement en dehors des circuits officiels, les ouvriers et surtout les paysans utilisent des moyens de communication comme internet pour échanger, discuter et débattre en recherchant les causes de leurs souffrances et du non développement de l’Afrique dans nos langues nationales. Comme l’écrit Ngugi wa Thiong’o pour la littérature, la poésie, le théâtre, tous les domaines de la vie sociale, culturelle, citoyenne, scientifique et intellectuelle sont influencés par les choix de classe, les choix philosophiques, idéologiques et par le regard que nous posons sur le monde et les rapports sociaux : « la question de la langue n’a de sens que si on l’examine dans un contexte économique et politique plus large ; et à travers elle, c’est la question du type de société que nous voulons. La recherche d’orientations linguistiques, littéraires, culturelles, dramatiques, poétiques, fictionnelles et universitaires nouvelles participe pleinement de la lutte des peuples africains contre l’impérialisme néo-colonial » (idem).
La presse d’expression française, anglaise, lusophone ou hispanique bien que nécessaire ne peut être qu’une phase transitoire dans le processus complexe et difficile du combat d’émancipation des peuples africains, combat qui, pour être conséquent jusqu’au bout, fécondera dans son développement une presse, une école, une recherche, etc., dans nos langues nationales.
Pour Pambazuka 25 juillet 2011
* Guy Marius Sagna et Fodé Roland Diagne sont membres de Ferñent/ Mouvement des Travailleurs Panafricains-Sénégal
* Veuillez envoyer vos commentaires à [email protected] ou commentez en ligne sur Pambazuka News
- Identifiez-vous pour poster des commentaires
- 671 lectures